Manger Bio
Publié : 18 avril 2013 Classé dans : Bio | Tags: agriculture, Bio Poster un commentaire« La mort lente et silencieuse des sols », la mise en danger de la biodiversité sauvage font partie des raisons de « manger bio », avec les questions de santé. Ce livre décrit aussi avec précision l’agriculture biologique, ses principes et évoque le débat sur ses dérives industrielles et commerciales…
« Manger Bio. Pourquoi ? Comment ? Le guide du consommateur éco-responsable ». Pascal Pavie et Moutsie. Editions Edisud, 2008.
Interview paru dans le Paysan du Midi du 12/12/2008
Manger Bio < Pascal Pavie et Moutsie sont les auteurs d’un livre sur l’alimentation bio mais aussi sur l’agriculture biologique, qui vient de paraître.
« L’agriculture écologique doit nourrir le monde »
Pascal Pavie, viticulteur à Festes-et-Saint-André, près de Limoux, depuis 1981, a des responsabilités à la Confédération Paysanne (à la Commission internationale) et à Nature et Progrès, dont il est certifié depuis 1981.
Moutsie est ethnobotaniste (étude des milieux, utilisation des plantes) et animatrice environnement à l’association L’Ortie. Elle est co-présidente Aude de Nature et Progrès.
Ils nous présentent leur livre.
Le Paysan du Midi : Pascal Pavie, lorsque vous vous êtes installé il y a 27 ans, la consommation de produits biologiques était symbolique en France. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Pascal Pavie : « Cela n’a pas beaucoup changé. La consommation bio est toujours très faible : 1 % des Français mangent bio tous les jours. Mais ce marché est en expansion de 9,5 % par an depuis dix ans.
La France, qui était le premier pays d’Europe pour la production bio dans les années 70, est presque le dernier aujourd’hui. On stagne à 2 % de la SAU (surface agricole utile) française. Cela par manque d’aides et donc de volonté politique.
De ce fait, on importe plus de 50 % des produits bio. C’est aberrant dans un pays agricole comme le nôtre. C’est une aberration écologique, pas seulement pour la santé humaine : un kilo de citrons, pour venir d’Afrique du Sud, consomme trois litres de gasoil. Et c’est pareil pour des denrées que l’on pourrait produire localement.
L’agriculture bio progresse plus vite en Italie, en Autriche, en Espagne… Ces pays ont une politique incitative, financée notamment par le 2e pilier de la Pac (Politique agricole commune de l’Union européenne) : en France, on a préféré mettre, dans ce 2e pilier, des mesures agrienvironnementales d’ordre général. »
Le Paysan du Midi : Mais manger bio coûte cher. N’est-ce pas un frein à l’expansion du bio ?
Moutsie : « Si l’on compare un produit bio et un même produit non bio, le premier sera plus cher ; mais manger bio, c’est manger autrement, c’est accepter de payer un juste prix pour avoir un produit de meilleure qualité et produit dans des conditions respectueuses de la planète.
C’est aussi manger moins de viande et davantage de légumes secs, moins de produits transformés, manger plus local, des produits de saison, acheter en vrac plutôt qu’avec beaucoup d’emballages, sur les marchés…
Il est vrai que les gens ne cuisinent plus, qu’ils achètent par exemple des soupes toutes prêtes, qui reviennent plus cher. On peut manger bio à un prix raisonnable. »
Pascal Pavie : « Concernant les coûts de production, il est certain que la bio demande plus de main-d’œuvre et a souvent des rendements moindres qu’en conventionnel. Donc on a des coûts plus élevés, mais cela c’est vrai en France, pas en Inde ou en Afrique. En France, il y une rente de situation du fait que l’énergie et les pesticides ne sont pas encore assez chers, et en plus ils n’incluent pas les dépenses de la collectivité pour la dépollution et la santé.
Par ailleurs, une exploitation bio perçoit, en moyenne, 25 à 40 % d’aides en moins qu’une exploitation conventionnelle. »
Le Paysan du Midi : Vous dites qu’il n’y a pas assez d’aides à l’agriculture bio ; ça va changer, avec le Grenelle de l’Environnement ?
Pascal Pavie : « Le Grenelle de l’Environnement a en effet pour ambition d’inverser la tendance, de passer à 6 % de la SAU bio en 2012 et à 10 % en 2020.
Pour cela, Michel Barnier (alors ministre de l’Agriculture) a décidé de déplafonner les aides à la conversion et au maintien (chacune de ces deux aides est actuellement plafonnée à 7 600 € par exploitation par an pendant cinq ans, Etat et Feader cumulés) (1).
Nous sommes en colère. Nous aurions préféré que l’argent serve à l’installation plutôt qu’à l’agrandissement. Nous ne voulons pas d’une agriculture bio à l’image de l’agriculture industrielle. Quand des responsables agricoles prônent l’introduction des OGM dans la bio, c’est qu’ils veulent appliquer les mêmes recettes de l’agriculture conventionnelle à la bio ; ils n’ont rien compris à la demande des consommateurs et risquent de faire couler le bateau sur lequel ils viennent juste de monter.
L’installation de jeunes agriculteurs en bio aurait permis de montrer l’importance sociale de l’AB en augmentant la production certes moins vite mais avec plus de diversité.
Le poids du lobby agro-industriel en France n’est pas étranger à ce genre de décision. La France est le premier pays d’Europe en consommation de pesticides et il en consomme deux fois plus que le deuxième pays, l’Allemagne.
Le scandale du soja bio chinois intoxiqué à la mélamine montre bien que le bio ne suffit plus, qu’il faut relocaliser la production et travailler sur des circuits plus courts. Le mouvement des Amap (Associations pour le maintien d’une l’agriculture paysanne), 1 200 en France, est annonciateur d’une nécessité d’aller plus loin que la bio, surtout si celle-ci est ainsi aspirée par le modèle agro-industriel ; nous appellerons cela l’agro-écologie.
Il faut en vouloir pour s’installer en bio. L’encadrement technique des chambres d’agriculture a été, jusqu’ici, quasi-inexistant. Il a fallu recourir à des services associatifs, comme ceux des Civam bio. La recherche s’intéresse peu à l’agriculture biologique : à l’Inra, 1,2 % des chercheurs travaillent sur la bio. »
Moutsie : « La stratégie des lobbies agro-industriels, ça a été aussi de mettre en place l’agriculture raisonnée, pour rassurer le consommateur et continuer à écouler leurs produits chimiques. »
Le Paysan du Midi : Cultiver en bio, c’est changer quelques pratiques ou c’est complètement différent ?
Pascal Pavie : « En agriculture biologique, on s’interdit tous les produits chimiques de synthèse (engrais, pesticides), avec quelques exceptions lorsqu’il n’y a pas d’alternative.
Il y a les textes et il y a l’esprit. Par exemple, on peut utiliser, en viticulture bio, la roténone, qui est un insecticide à très large spectre et qui donc tue tous les auxiliaires. Ce n’est pas satisfaisant.
Cultiver en bio, ce n’est pas seulement remplacer les produits chimiques par des produits moins nocifs. C’est aussi cultiver autrement : d’abord rétablir l’équilibre des sols, l’humus ; c’est favoriser la biodiversité pour avoir des insectes auxiliaires ; c’est limiter la fumure azotée, et parfois produire un peu moins.
Par ailleurs, en agriculture biologique, il ne devrait pas y avoir de monoculture. Réinstaller des haies, laisser le sol enherbé réduit les risques.
Certes, ce n’est pas magique : dans mes vignes, je ne sais plus ce qu’est l’araignée rouge mais par contre j’ai toujours du mildiou. Pour nombre de maladies et de ravageurs, on manque d’aide expérimentale.
Et puis, en bio, on ne peut pas prétendre faire partie du club des 100 quintaux de céréales ; et il faut valoriser davantage les produits. Mais, par exemple, en viticulture AOC (appellation d’origine contrôlée), ça passe très bien. En productions animales on a les mêmes productivités qu’en non-bio.
Le déplafonnement des aides à la conversion va encourager une agriculture bio intensive. On va pouvoir, tout en respectant le cahier des charges, produire des salades en monoculture sur 20 ha, avec des intrants importés, sans biodiversité et dans un esprit de rentabilité haute. Ce n’est pas ainsi que nous voyons l’agriculture biologique. »
Le Paysan du Midi : Face à la crise alimentaire des pays en voie de développement, on dit que l’agriculture biologique a la capacité à nourrir la population mondiale… ?
Pascal Pavie : « A la question « L’agriculture bio peut-elle nourrir le monde ? », il faut, aujourd’hui, répondre : l’agriculture biologique doit nourrir le monde.
Le colloque de la FAO (2) à Rome, en mai 2007, a conclu que l’agriculture biologique est capable de nourrir la planète et qu’elle est l’avenir. Beaucoup de pays, de toutes façons, ont une agriculture biologique ou presque. Ce qui manque aux paysans du tiers monde, c’est des terres et c’est d’apprendre à jardiner sans les intrants qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter (3).
Ce qui a sorti l’Europe de la famine au XIXe, ce n’est pas l’agriculture chimique, c’est une technique bio : l’assolement triennal et la fumure organique ; la chimie est arrivée après.
L’agriculture biologique, exigeante en main-d’œuvre, maintient les gens dans les zones rurales, évitant l’exode vers les bidonvilles surpeuplés.
Elle a fait ses preuves en termes de qualité des produits. Il faut aujourd’hui qu’elle change d’image et soit perçue comme une vraie alternative. »
Propos recueillis par Philippe Cazal
1) Pour atteindre ce plafond, il faudrait par exemple convertir 12 ha de maraîchage, 21 ha de vigne ou 38 ha de céréales.
2) FAO : Organisation de l’Onu pour l’alimentation et l’agriculture.
3) François de Ravignan développe ce point de vue dans « La Faim, pourquoi ?« .
Un « guide du consommateur éco-responsable »
« Manger Bio. Pourquoi ? Comment ? Le guide du consommateur éco-responsable », de Pascal Pavie et Moutsie, est paru aux éditions Edisud (145 pages, format 17 x 23, nombreuses illustrations couleur, 18 €). En vente en librairie. Edisud : tél. 04 42 21 61 44, fax. 04 42 21 56 20, info@edisud.com , http://www.edisud.com
L’ouvrage, préfacé par François de Ravignan, dresse, dans sa première partie, un état de la planète, et notamment de la « mort lente et silencieuse » des sols et du danger encouru par la biodiversité sauvage.
« Relation alimentation et santé », la 2e partie, évoque « ce qui se cache dans nos assiettes » mais aussi sur les étiquettes.
L’agriculture biologique, ses principes, sa certification sont largement développés dans la 3e partie, qui évoque aussi le débat entre les puristes du bio et les formes plus ou moins édulcorées (4).
Les produits et les différents modes de commercialisation font l’objet des derniers chapitres, avec des informations très pratiques sur les réseaux de magasins.
4) Sur ce débat, lire « La Bio entre business et projet de société« .
La Bio entre business et projet de société
Publié : 25 mars 2013 Classé dans : Bio | Tags: alimentation, Bio Poster un commentaireEntre éthique et business ‹ L’agriculture bio est-elle en train d’échapper à ses précurseurs pour devenir un agro-business comme les autres ?
« La Bio entre business et projet de société ». Livre collectif, sous la direction de Philippe Baqué. Contre-feux, Agone, 2012.
La Bio à la croisée des chemins
Quelle différence y a-t-il entre une tomate bio et une tomate bio ? En termes de qualité alimentaire, peut-être pas beaucoup. Mais la différence peut être considérable entre deux tomates labellisées bio selon la façon dont elles ont été produites, différence en termes d’impact sur l’environnement et la biodiversité, de revenu du producteur, de développement local ou de conditions de travail des salariés.
En fait, qu’est-ce que l’agriculture biologique ? Peut-on se contenter de lui demander de fournir une alimentation saine ou est-ce une démarche plus globale, qui s’intéresse au contexte social et politique de cette agriculture ?
Le livre « La Bio entre business et projet de société », paru ce printemps aux éditions Agone sous la direction de Philippe Baqué, pose ces questions et s’efforce d’y répondre, à travers une série de reportages en France et dans le monde.
L’idée de réaliser ce livre est née parmi un groupe de journalistes indépendants, agriculteurs, agronome, économiste, sociologue, militants… qui se sont mis au travail ensemble.
L’ouvrage, très riche en exemples et en témoignages, s’appuie d’abord sur l’observation de la réalité et sur l’évolution de la bio à travers son histoire. Pour mieux amener la réflexion et s’interroger sur les choix de société qui sous-tendent deux façons de faire de l’agriculture biologique.
Car si les agriculteurs biologiques étaient, il y a peu, considérés comme des marginaux, la bio est devenue un créneau en fort développement. D’où un mouvement important de conversion d’agriculteurs du conventionnel à la bio. Mais aussi un fort courant d’importation : 35 % des produits bio consommés en France sont importés (et 60 % des fruits et légumes).
Ces aliments bio, français, européens ou venant de plus loin, sont produits le plus souvent avec des méthodes de culture et d’élevage industrielles, en monoculture, dans une logique de réduction des coûts et de compétition qui entraîne l’exploitation de la main-d’œuvre (ou du paysan en intégration, voire l’auto-exploitation du coopérateur) et le pillage des ressources naturelles.
Le goût amer de l’huile de palme
En Colombie, le groupe Daabon cultive (à côté d’immenses superficies en conventionnel) environ 4 500 ha de palmiers à huile et 1 000 ha de bananiers en agriculture biologique. Ces grandes exploitations de monoculture à hauts rendements produisent pour l’exportation et fournissent la distribution européenne (GD et magasins spécialisés) et l’industrie des cosmétiques. On sait que l’huile de palme, en raison de son bas prix notamment, rentre aujourd’hui dans la composition d’un grand nombre de produits alimentaires et cosmétiques, consommés en France notamment.
Daabon est aussi un important producteur d’agro-carburants.
Le groupe est accusé d’avoir entretenu des liens avec les paramilitaires colombiens. En Colombie, il est fréquent, à la faveur de l’instabilité causée par la lutte entre l’Etat et la guérilla, que les gros propriétaires fassent chasser les paysans de leurs terres pour prendre leur place.
Par ailleurs, avant les années 1990, la Colombie était autosuffisante sur le plan alimentaire. Depuis, la production agro-industrielle pour l’exportation a explosé et aujourd’hui la Colombie importe massivement des aliments de base.
Le label bio européen, note l’auteur de ce chapitre, bien qu’il « incite » à la biodiversité, autorise la monoculture de plantes pérennes ; il ne limite pas la taille des exploitations et ne comprend aucun critère social.
Acheter des produits bio de Daabon, n’est-ce pas cautionner l’expulsion des paysans, les crimes des paramilitaires, le triomphe des agro-carburants au détriment des cultures vivrières ? Or, souligne l’auteur, Daabon continue à bénéficier, en France, « du soutien inconditionnel du réseau Biocoop », le leader de la distribution spécialisée de produits bio.
Des poulets bio à croissance forcée
Dans le Sud-Ouest de la France, Maïsadour est l’un des leaders du poulet bio. La production est intégrée : la coopérative livre les poussins et les aliments, rachète les poulets et les commercialise. Le label européen permet la production dans des bâtiments jusqu’à 1 600 m2, avec des densités de 16 volailles au m2 pour les bâtiments mobiles et 10 pour les bâtiments fixes. Tous les poussins sont vaccinés, l’épointage du bec est possible, les antibiotiques sont autorisés (un par an pour les poulets de chair, trois pour les poules pondeuses), les antiparasitaires aussi et l’abattage peut intervenir à 81 jours.
L’aliment bio pour les volailles est à base de maïs (surtout d’Italie) et de soja (du Brésil, de Chine ? Un certain flou règne sur la provenance).
Au Brésil, le soja bio est produit sur des fermes de plusieurs milliers d’hectares, surtout dans le Mato Grosso, l’Etat du Brésil où la déforestation est la plus forte. Le label bio européen n’interdit pas de cultiver sur des terres issues de la déforestation.
A côté de l’élevage bio intensif, des petits producteurs, dans le Sud-Ouest, travaillent dans le souci de la biodiversité sur leur exploitation (volailles, autres élevages, céréales, oléagineux, arbo…), transforment souvent artisanalement, vendent en circuit court. L’aliment des animaux vient de la ferme ou de fermes voisines. La taille des élevages est limitée, les poulets sont abattus à 120 ou 130 jours, pour le goût et la qualité de la viande…
L’auteur du chapitre illustre l’impact du système de production sur le revenu de l’agriculteur avec deux exemples : celui, d’abord, d’un éleveur bio traditionnel de volailles, qui vend celles-ci à 7,50 €/kilo. Avec un coût de production de 2,80 € et un coût de mise en marché de 1,30 €, il dégage un revenu de 3,40 €/kilo. Et l’exemple d’un éleveur en système intégré : l’intégrateur vend les volailles 5,50 €/kilo ; le coût de production est de 2,70 €/kilo et la marge de l’intégrateur de 2,20 €/kilo, ce qui laisse 0,60 €/kilo au producteur. « D’où la tendance à devoir produire toujours plus ».
Fruits et légumes intensifs, salariés malmenés
En Andalousie, la mer de plastique des provinces d’Almeria et Huelva des années 1980 est toujours là. Mais une partie des producteurs se sont reconvertis à la bio, pour tenter de lutter contre la baisse des prix qui leur sont payés.
Des ouvrières agricoles dans les serres de fraises bio du Sud de l’Espagne.
Photo Philippe Baqué.
Il est difficile de trouver une différence entre les productions bio et conventionnelles. Les fraises du Parc de Doñana (province de Huelva) sont cultivées en hors-sol dans une culture hydroponique qui ne dit pas son nom. En bio comme en conventionnel, elles sont la cause de l’assèchement de la nappe phréatique du parc naturel.
Les travailleuses, immigrées, qui soignent ces cultures, les récoltent et les conditionnent sont la plupart du temps en contrats précaires, payées en dessous des tarifs conventionnels, les heures supplémentaires non payées, les passeports confisqués… Les syndicats, bien sûr, sont interdits de séjour.
A côté, en Andalousie, de petits producteurs bio travaillent de façon traditionnelle, commercialisent en circuits courts ou à travers des coopératives.
Au Sud du Maroc, en particulier dans la province de Chtouka Aït Baha, d’importantes exploitations produisent massivement des fruits et légumes bio pour l’exportation sans considération pour les dégâts environnementaux et sans respect du droit du travail : salaires inférieurs au salaire minimum, salariées non déclarées ni inscrites à la caisse de sécurité sociale… Après avoir épuisé les terres et la nappe phréatique du Souss, ces entreprises se reportent, avec les mêmes méthodes, vers la région de Dakhla, au Sahara Occidental (sous domination marocaine en dépit des résolutions de l’Onu).
La GD est arrivée
Après avoir considéré le bio comme une niche (1992, apparition des premiers produits bio chez Carrefour), la grande distribution a fortement développé ce créneau à partir de 2008. Elle a alors décidé d’éliminer ses concurrents (les magasins spécialisés avant tout) ; cela avec un argument déjà utilisé pour le conventionnel, « la défense du pouvoir d’achat des consommateurs » et les prix bas.
Le conditionnement de tomates bio, en Espagne.
Photo Philippe Baqué.
Cela n’empêche pas la GD de réaliser des marges importantes sur les produits bio, d’imposer des prix bas aux fournisseurs, à travers les marques distributeur, et d’oublier de parler du revenu des producteurs (et de leur « pouvoir d’achat »).
Résultat, la GD maîtrise aujourd’hui en France 47 % du chiffre d’affaires du Bio. Ces produits bio sont en bonne partie importés, produits dans des pays où le prix de la terre est peu élevé, la main-d’œuvre peu coûteuse. La GD française les achète à peine plus cher que les produits conventionnels, parfois moins cher, et réalise dessus des marges très importantes.
Retour aux fondamentaux ?
« La Bio entre business et projet de société » rappelle les principes fondateurs de la Bio et retrace le développement de l’agriculture biologique : coopérative Demeter (1932), Association française d’agriculture biologique (1962), Nature & Progrès (1964), Ifoam (fédération internationale, 1972), Fnab (1978).
Puis la reconnaissance officielle de l’agriculture biologique (1980) et le processus jusqu’à la naissance du label européen (2009), plus laxiste que le label français (lequel, désormais, ne peut plus imposer un cahier des charges plus rigoureux que le cahier des charges européen). Un processus de reconnaissance qui aboutit à la « confiscation » de la labellisation par les pouvoirs publics… au profit du lobby agro-industriel et de la grande distribution ? (1)
Le livre ouvre le débat sur les avantages comparatifs du SPG (système participatif de garantie), créé par Nature & Progrès, et de la réglementation européenne. D’un côté une relation de confiance producteurs-consommateurs (qui inclut aussi des contrôles) ; de l’autre, une certification où le certificateur « indépendant » contrôle les entreprises productrices… qui sont ses clients et le font vivre.
Le parcours des « acteurs de la Bio » en France est lui aussi instructif, du mouvement militant aux entreprises dont certaines ont peut-être perdu de vue leurs objectifs d’origine. La plupart se sont mises à travailler avec la grande distribution, comme passage obligé du développement ; certaines en reviennent.
Biocoop, pionnier de la distribution bio, est devenu un réseau de commerçants indépendants (2) où la partie coopérative se limite à la centrale d’achat. S’il conserve une vie démocratique, avec de vrais débats, les consommateurs et les producteurs sont peu impliqués dans les décisions. Et la course au développement commercial a pris le dessus, entraînant des pratiques contestables du point de vue de l’éthique de la bio : importations de contre-saison, produits de la bio industrielle mis en avant (pour leurs prix inférieurs), produits issus d’entreprises sans éthique sociale… Est-ce le résultat d’une perte de contrôle de la base ?
Mais le mouvement social à l’origine des Biocoop dans les années 1980 réapparaît sous diverses formes : groupements d’achat, Amap (la charte des Amap est écrite en 2003 par Alliance Provence, le réseau des Amap de Provence-Alpes-Côte d’Azur), boutiques de producteurs fermiers (dont les Boutiques Paysannes en Languedoc)… Le but de ces nouveaux militants : s’éloigner des pratiques de la GD, mettre l’alimentation au centre du débat politique.
Les auteurs de « La Bio entre business et projet de société » proposent, pour parer aux dérives de la Bio et sortir de ses contradictions, un recentrage sur l’agro-écologie. Cette notion regarde la durabilité des agro-écosystèmes, sur le plan environnemental mais aussi en terme de bien-être des sociétés humaines. Elle donne une part prépondérante aux savoirs paysans, ce qui n’empêche pas leur propre remise en cause.
Elle va donc bien au-delà de la vision limitative que les organismes de recherche (Inra, Cirad) ont souvent de l’agro-écologie : l’ensemble des techniques agronomiques permettant de préserver l’équilibre écologique. Vision qui a donné notamment l’Agriculture Ecologiquement Intensive et l’agriculture à Haute Valeur Environnementale. Des tendances pour détourner l’agriculture biologique ?
L’agriculture paysanne est capable de nourrir la planète sans la détruire, estiment les auteurs, qui parlent aussi de souveraineté alimentaire, de droit à la terre et d’alimentation biologique accessible à tous. Tout un projet de société.
Philippe Cazal (paru dans le Paysan du Midi du 24/08/2012).
.
1) Pour les aspects réglementaires, voir informations et textes de référence sur http://www.agribio-languedoc-roussillon.fr (onglet « réglementation ») et http://www.bio-provence.org
2) Sept magasins Biocoop seulement ont conservé un statut associatif, dont ceux de Limoux (11), Alès et Saint-Hippolyte-du-Fort (30), Carpentras (84), Mane (04) et Eourres (05). Par contre, celui d’Aix-en-Provence a été le premier à passer du statut coopératif à celui de SARL, en 1991.
.
17 M€ pour encourager la Bio, 196 M€ pour les agrocarburants
L’Etat, à partir du Grenelle de l’Environnement, a beaucoup communiqué sur son accompagnement du développement de l’agriculture biologique en France.
Un appui tout relatif : il suffit de comparer les 17 M€ versés en 2011 à travers un crédit d’impôt aux agriculteurs certifiés (la mesure phare du Grenelle) aux 196 M€ d’aides aux agrocarburants pour la même année.
La Bio en contradiction avec ses semences
Les semences utilisées en agriculture biologique doivent être inscrites au Catalogue Officiel des Espèces et Variétés Végétales, géré par le Gnis (Groupement national interprofessionnel des semences). Or, la plupart des semences de ferme, celles qui font la biodiversité (et l’adaptation des semences à la grande variabilité des conditions de sol et de climat), ne sont pas inscrites au catalogue. Il existe, par exemple, plus de 150 000 variétés de riz ; quelques dizaines sont inscrites au catalogue.
Le cahier des charges bio européen considère comme semence biologique une semence qui a été cultivée en bio au moins une génération. La semence bio est donc une semence conventionnelle cultivée un an en bio.
Les semences conventionnelles sont en grande majorité issues de la sélection génétique par hybridation, ce qui est contradictoire avec deux des principes de la Bio : le choix des processus naturels pour la sélection de variétés nouvelles et la recherche de la biodiversité.
La loi du 8/12/2011 durcit les règles d’utilisation des semences de ferme, ce qui fait des semences sélectionnées, inscrites au catalogue, le passage obligé en dehors de la consommation familiale.
Lire aussi « Manger bio« .

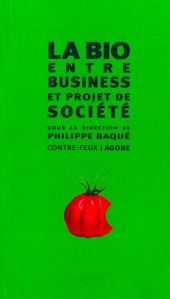


Commentaires récents