Publié : 28 février 2023 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Alimentation, Bien public, Biodiversité | Tags: Agro-foresterie, alimentation, Chêne, Commun, Dehesa, Gland |
Cadeau de la nature qu’il suffit de ramasser, le gland a de tous temps participé à l’alimentation humaine dans les régions du pourtour méditerranéen, en particulier en période de disette. En Espagne et au Portugal, il trouve un regain d’intérêt dans un esprit de redécouverte d’une production traditionnelle et de mise en valeur d’une ressource naturelle.
On connaît le fameux jambon « ibérico de bellota », le jambon de cochons nourris aux glands en Extremadura (sud-ouest de l’Espagne). Il fait partie d’un système d’élevage qui a pour cadre la « dehesa », ce parcours planté de chênes clairsemés, exemple d’agro-foresterie traditionnelle que l’on retrouve aussi en Andalousie et au sud du Portugal (Alentejo).
Ce que l’on sait moins c’est que les glands ont été utilisés en alimentation humaine sur tout le pourtour méditerranéen et notamment en Espagne depuis le temps des chasseurs-cueilleurs, au Paléolithique, d’abord en fruit de cueillette puis en complément des cultures de céréales ; et cela jusque dans les années 1960. Ils ont joué un grand rôle dans les périodes de famine, sauvant bien des vies humaines. Un livre récemment paru rapporte de nombreux témoignages de l’utilisation des glands à travers l’histoire (1).

Cette pratique de consommation des glands faisait partie du système de vie rurale, où les bois et la forêt étaient un commun, appartenant à la communauté villageoise, riche en ressources (bois de chauffage et de construction, fourrage de feuilles d’arbres, baies, champignons, gibier, plantes médicinales, etc.) et jouant par conséquent un rôle déterminant dans l’économie locale, à côté des cultures.
Les boisements de chênes ont donc été soignés par les habitants, parfois en plantant des arbres, le plus souvent en sélectionnant ceux qui produisaient les meilleurs glands et en coupant les moins intéressants.
Les glands de toutes les espèces de chênes sont comestibles mais leur teneur en tanins varie, ce qui exige de désamériser ceux qui ont de fortes teneurs en tanins (et donc en toxines).
En élevage, les porcs mangent sans problème toutes les espèces de glands parce que, comme les sangliers et les cerfs, ils ont développé des défenses contre les tanins. Ce n’est pas le cas des équins, des bovins et des ovins, qui peuvent tomber gravement malades après l’ingestion de glands amers.
Les glands doux sont produits par un chêne vert, le Quercus ilex subsp. ballota ou le Quercus ilex subsp. rotundifolia, que les botanistes considèrent tantôt comme deux sous-espèces très proches, tantôt comme la même sous-espèce. On trouve ce chêne dans la majeure partie de la péninsule ibérique et au Maghreb. Ses feuilles sont plus arrondies et moins porteuses de piquants que celles de l’autre chêne vert, Quercus ilex ilex.
Celui-ci, aux glands amers, est très présent au nord de l’Espagne (côte atlantique et Catalogne), dans le sud de la France, en Italie et en Grèce.
Les autres espèces donnent des glands encore plus amers : Quercus suber (chêne liège), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus pubescens (chêne pubescent), Quercus coccifera (chêne kermès). Mais tous leurs glands sont utilisables.
On a noté qu’il existe des variations, pour la teneur en tanins, non seulement entre espèces mais aussi entre arbres de la même espèce et entre les différentes parties d’un même arbre. Les anciens en tenaient compte dans leur travail de sélection.
La récolte des glands a lieu selon les régions à partir de la fin septembre, surtout en octobre pour Quercus ilex ilex, parfois en février pour Quercus coccifera. La glandée est assez irrégulière selon les années.
Les glands doivent être cueillis à maturité, soit quand ils sont tombés au sol soit en secouant les branches avec de longues baguettes.
Ils peuvent être mangés frais ; ils le restent au maximum trois mois. Au-delà il y a plusieurs méthodes de conservation : le séchage, la torréfaction et aussi, dans l’Antiquité, l’immersion dans de l’eau.
Les méthodes de conservation servent aussi à désamériser les glands : on peut les lessiver, comme les olives, les faire sécher, les faire cuire dans de l’eau, ou encore les griller (dans la braise ou, par exemple, avec une poêle munie de trous ; il faut les fendre pour qu’ils n’éclatent pas).
Avant de les manger on les pèle pour enlever le péricarpe (écorce) et le tégument (peau) et ne manger que la chair (les cotylédons).
Le gland de chêne est riche en protéines et acides gras monoinsaturés. Il a été utilisé en médecine, encore au XXe siècle, contre la diarrhée, à cause de ses tanins.
En Espagne et au Portugal, on voit un mouvement de réhabilitation du gland dans l’alimentation et la gastronomie. Les usages culinaires sont nombreux : nature verts (pour les doux), séchés ou grillés ; en farine (pour le pain et la pâtisserie) ; en purée, en tourtes, omelettes, croquettes, crêpes ; et même pour faire de la bière et de la liqueur.
Ce retour du gland de chêne est en rapport avec le développement d’une économie rurale qui met à profit les traditions et en même temps avec une prise en compte de la diversité des ressources naturelles : il s’agit non seulement de cesser de détruire la nature mais aussi de la prendre comme elle est, avec ses richesses.
Ph.C.
1) « Las bellotas y el ser humano. Avatares de un símbolo en la península ibérica », Enrique García Gómez et Juan Pereira Sieso, Éditions Cuarto centenario, 2022.
Publié : 9 avril 2019 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Bien public | Tags: Balkans, Bosnie, Carnet de voyage, Franck Turlan, Guerre, Paix, République Serbe de Bosnie, Rencontre, Srebrenica, Tolérance, Vélo |
En Europe à vélo, par temps de paix
Dans ce carnet de voyage, Franck Turlan raconte son aventure vers la liberté et la rencontre des autres, dans une région d’Europe où parler de paix est tout sauf anodin.

Le mémorial de Srebrenica. 8 372 tombes éclairées par un soleil matinal : un signe d’espoir de paix ? (Photo Franck Turlan).
Le vélo c’est un moyen de voyager en liberté, hors des routes nationales ; c’est aussi un moyen de déplacement doux qui favorise la rencontre avec les autres. Franck Turlan avait déjà réalisé deux voyages à vélo, en Espagne et en Italie. En 2017, il s’est fixé l’objectif de joindre Lézignan-Corbières (son lieu de résidence) aux Balkans.
Ce journaliste, ancien coureur cycliste en compétition amateur, avait alors 45 ans. Avec une certaine expérience dans ces deux domaines.
Il part, seul avec son vélo, à l’été 2017, de Nîmes pour rejoindre Thessalonique, en Grèce, en traversant les Alpes, l’Italie, la Suisse, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, l’Albanie, la Macédoine et le nord de la Grèce. 4 000 km sur routes et chemins de cette Europe alpine puis balkanique.
Dans ce voyage il y avait peut-être le goût du défi, celui de la découverte, mais aussi, dit Franck T., « l’envie de me ressourcer », et surtout, explique-t-il, il y avait eu les élections présidentielles du printemps 2017 « avec un vote très fort du Front National à Lézignan-Corbières ». Il fait le rapprochement entre la vogue, en France, des propos de haine et de rejet de l’autre et le souvenir d’un événement qui l’avait fortement marqué il y a deux décennies, le massacre de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine (juillet 1995) : « A l’époque, je ne pensais pas qu’une chose aussi horrible puisse arriver en Europe, avec nos dirigeants de l’Union Européenne totalement impuissants, complices. » Il se demande alors comment partager le refus de tout cela et décide d’aller là-bas.
Il partagera cette aventure avec les lecteurs de L’Indépendant, moyennant une chronique hebdomadaire qui, dit-il, a donné de bons retours. Ces chroniques ont été réunies récemment à compte d’auteur dans un petit livre « Sur la route des Balkans. Chronique d’un voyage en Europe à vélo, par temps de paix ».
On suit avec plaisir ce récit vivant, agréable à lire. On vit avec l’auteur les péripéties du voyage, la rude ascension des cols, l’angoisse de trouver un hébergement pour la nuit, les conséquences d’un excès de confiance dans les cartes qui mènent dans des impasses, les moments d’errement dans la forêt à la recherche du bon chemin… Et on s’imagine, comme F. Turlan, emprunter en toute liberté la « route secrète » qui descend vers Turin, un moyen d’échapper au flot des voitures et d’être plus près de la nature.
Et puis il y a les rencontres, plus ou moins approfondies, selon les facilités ou le barrage de la langue, selon les circonstances et les individus.
« En tant que voyageur », dit F. Turlan, « j’espère rencontrer des personnes riches d’une identité propre ; rencontrer une altérité, et me nourrir d’une diversité culturelle ». Il touchera du doigt, au cours de son voyage, le fait que l’identité a deux faces ; elle peut révéler la richesse d’une personne ; elle peut aussi, lorsqu’elle est exacerbée, devenir un facteur de repli sur soi et de rejet des autres.
Au cœur des Balkans, principal objet de ce voyage, F. Turlan a tenté de sonder les états d’esprit de ses interlocuteurs par rapport aux événements du passé. Il a trouvé tantôt de l’ouverture aux autres, une volonté de paix, tantôt une fermeture, parfois figée sur l’opposition qui a mené à la guerre, du déni aussi de ce qui est arrivé et l’absence des uns ou des autres de remise en cause de leurs responsabilités.
La position du journaliste à vélo n’était pas simple : il a été parfois vu comme un représentant de l’Union européenne, celle qui « nous a lâchés », estime un musulman de Bosnie, celle « qui nous assassine économiquement ».
Franck T. s’abstient de juger. Il est conscient que l’histoire de cette région est complexe, avec de vieux contentieux non réglés et des idéologues va-t-en guerre qui manipulent la réalité.
De retour des Balkans, il voudrait aller plus loin, peut-être y revenir pour réaliser un travail avec des jeunes bosniaques et serbes, contribuer à une prise de conscience collective des voies qui peuvent mener à la paix… définitivement.
Ce livre, en tout cas, est une contribution dans ce sens.
On peut le trouver (12 €) dans les librairies narbonnaises Libellis (43, rue Droite) et Le Livre Voyageur (28, rue Ancienne Porte de Béziers-angle Place du Forum) et carcassonnaise Mots et Compagnie (35, rue Armagnac).
Ou auprès de l’auteur : franck.turlan@mailoo.org ; voir aussi son blog https://velovoyageblog.wordpress.com

Fresque murale à l’entrée de Srebrenica (Photo Franck Turlan)
Publié : 29 décembre 2017 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Social, Vie citoyenne | Tags: 1945, Bernard Friot, Conquêtes sociales, Emanciper le travail, Marché du travail, Ordonnances de 1945, Propriété lucrative, Réseau salariat, Retraite, Salaire à vie, Salaire socialisé, Sécurité Sociale, Valeur économique, Valeur d'usage |
Invite à renforcer les conquêtes sociales de 1945
Dans « Émanciper le travail », Bernard Friot appelle à revenir à l’esprit des conquêtes ouvrières de 1945. En instaurant le salaire à vie des fonctionnaires et les systèmes de retraite et de Sécurité Sociale, elles ont affirmé leur définition de la valeur d’usage du travail face à celle du capitalisme qui ne considère comme travail que celui sur lequel il peut s’enrichir. Depuis, cette victoire est peu à peu remise en cause. Pour redevenir la classe dominante, le salariat doit imposer ses propres valeurs.

« Émanciper le travail », Bernard Friot, entretiens avec Patrick Zech, Ed. La Dispute, 2014.
La bourgeoisie, du XIVe au XIXe siècle, explique Bernard Friot dans ce petit livre, a imposé, contre le féodalisme, ses propres institutions de la valeur économique : la propriété lucrative, le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps de travail et le crédit.
En maîtrisant la production de valeur par la propriété lucrative des outils de production, cette bourgeoisie s’approprie une partie du fruit du travail du reste de la société (« le capitalisme est né de l’expropriation et continue à reposer sur elle« ).
Par le marché du travail et la mesure de la valeur par le temps de travail, non seulement elle rend le salarié dépendant d’une logique de création de valeur ajoutée à son profit (à elle) mais aussi elle impose l’idée que seul le travail marchand peut être considéré comme productif ; ce qui implique que les autres types de travail, celui des fonctionnaires, celui des soignants dont le salaire est financé par la Sécurité Sociale, ou encore l’activité sociale des retraités seraient « improductifs« .
Le crédit lucratif, lui, est une autre façon de détourner la valeur ajoutée au profit de ceux qui détiennent le capital.
Face à cette vision capitaliste d’une « valeur économique » maîtrisée par le capital, la classe ouvrière, à partir de 1945, a imposé une autre vision, celle de la « valeur d’usage » produite par tout travailleur, et de la mutualisation de la valeur ajoutée.
C’est cette vision de la classe ouvrière que les « réformateurs » s’emploient à détricoter depuis 30 ans, depuis les gouvernements Chirac et Rocard aux présidences de François Hollande et d’Alain Macron, avec l’aide de certains syndicats, en particulier la CFDT.
Les conquêtes de 1945, dit B. Friot, sont anticapitalistes parce qu’elles affirment qu’il est tout à fait possible à une classe sociale, le salariat (la classe ouvrière élargie), de produire de la valeur sans propriété lucrative (sans capital et sans actionnaires à rémunérer), sans crédit lucratif. Cette possibilité n’est pas une utopie mais une réalité déjà largement mise en œuvre à travers la « cotisation-salaire« , le « salaire à vie« des fonctionnaires et les conventions collectives.
La cotisation-salaire (ou salaire socialisé) finance, par ponction sur la valeur ajoutée du travail, la Sécurité Sociale, c’est-à-dire la prise en charge des soins de santé mais surtout le salaire des travailleurs de santé du public (l’Hôpital) et le revenu des professionnels de santé conventionnés secteur I ; elle finance aussi une partie des retraites (la retraite « de base ») ; et aussi, jusqu’à présent, le revenu des chômeurs et, par les allocations familiales, une partie du travail des parents.
C’est l’impôt qui finance le salaire et la retraite des fonctionnaires, les soustrayant eux aussi au marché du travail.
Les conventions collectives, en reconnaissant la qualification des travailleurs, lient leur salaire à cette qualification (qui leur appartient et peut constituer la base du salaire à vie) et non au poste (qui appartient au patron et dont celui-ci peut priver le travailleur).
B. Friot exhorte les travailleurs à se battre pour généraliser ces « institutions du salaire« , afin qu’elles remplacent les institutions capitalistes ; ce qui demande d’abolir la propriété lucrative de l’outil de travail pour la remplacer par la propriété d’usage (1) des entreprises par les travailleurs, d’instaurer un financement des entreprises sans appel au crédit lucratif et d’élargir à tous le salaire à vie financé par la mutualisation de la valeur ajoutée à l’échelle de toute la société.
Au passage, la propriété lucrative immobilière, qui permet à un propriétaire (à partir de son capital) de tirer un revenu au détriment du locataire, serait également abolie (2).
Plus largement, il faudrait étendre ou instaurer la gratuité de la santé, de l’éducation, du logement, des transports de proximité et de la première consommation d’eau et d’énergie.
Avec la propriété lucrative de l’outil de travail, bien que ce soient les travailleurs qui produisent la valeur économique, les propriétaires, qui ne produisent rien, s’approprient la valeur économique et maîtrisent sa répartition, tout en soumettant les travailleurs au chantage de l’emploi.
Aujourd’hui, les propriétaires lucratifs de l’outil de travail (propriétaires directs, actionnaires ou prêteurs) ponctionnent 35 % de la valeur ajoutée et en affectent 20 à l’investissement et 15 aux dividendes et aux frais financiers (rémunération des prêteurs). L’abolition de la propriété lucrative supprimerait le détournement de ces 15 % de la valeur ajoutée.
La réduction de la hiérarchie des salaires à une fourchette allant de 1 à 4 réduirait aussi les inégalités.
Les travailleurs, co-propriétaires d’usage de leur outil de travail (3), seraient maîtres de la gestion de l’entreprise mais n’en tireraient pas directement leur salaire. Les entreprises verseraient en effet une cotisation à une caisse nationale « de cotisations sociales« , qui répartirait les salaires selon la qualification de chacun, que l’on soit en activité, en maladie, à la retraite (4). Les entreprises investiraient sur fonds propres et alimenteraient par ailleurs une caisse nationale « de cotisation économique » qui subventionnerait les projets d’investissement le nécessitant.
La guerre des mots
Dans leur entreprise de démantèlement des institutions du salaire, les capitalistes, dit Bernard Friot, cherchent à distinguer travail productif et travail improductif, à nier aux « improductifs » le droit au salaire. Ils cherchent aussi à distinguer le salaire des autres droits (retraite, indemnité de chômage, allocations familiales, couverture maladie) et poussent à ce que ceux-ci soient de moins en moins financés directement sur le salaire et de plus en plus par d’autres moyens : « cotisation-prévoyance » (l’épargne constituée par le salarié qui lui permettra de toucher plus tard un « revenu différé« ), impôt (CSG), solidarité nationale.
La retraite complémentaire (Agirc et Arrco) se situe déjà dans l’esprit de cotisation-prévoyance.
Les institutions ouvrières du salaire, au contraire, considèrent, avec le salaire à vie, que le salaire, avec toutes ses composantes, devient un droit politique personnel ; toute personne est reconnue comme productrice de valeur économique. C’est la mutualisation de la valeur ajoutée qui permet de payer les salaires à vie et non le travail marchandisé, la « cotisation-prévoyance » de chacun ou l’impôt.
Sur le plan stratégique, Bernard Friot estime vaines les « stratégies d’évitement » qui consistent à se battre pour préserver les acquis, sur un mode défensif, ou à les améliorer (temps de travail, revenu de base…). Il faut, dit-il, avoir une stratégie offensive en se battant pour imposer notre définition de la valeur contre la définition capitaliste. C’est une erreur, dit-il, de se battre en priorité sur le curseur, c’est-à-dire pour une meilleure répartition de la valeur ; le combat fondamental c’est la définition de la valeur et sa maîtrise par les salariés. « L’actuelle production de valeur d’usage est une catastrophe écologique, pour le travail concret des producteurs et anthropologique. » Il faut changer de modèle.
En remettant en cause la définition capitaliste de la valeur économique, qui fait reposer la production de richesses uniquement sur le travail dit « productif« , c’est-à-dire marchandisé, on remet en cause le mythe du développement qui voudrait que celui-ci repose sur le marché et l’expansion à l’infini de la production. Combattre ce mythe, c’est aussi affirmer que le développement doit être avant tout un développement humain, hors du marché, qui repose sur l’accès de tous à l’éducation, à la santé, à la culture, aux loisirs, aux relations humaines et à la vie sociale. Ce qui n’empêche pas de viser en même temps un développement matériel concernant le logement, une alimentation saine, etc.
Dans ce livre, Bernard Friot passe beaucoup de temps à démonter les arguments de la pensée dominante : « Je mène la guerre des mots afin de ne pas la laisser aux seuls réformateurs« , dit-il. Sa démonstration, qui montre qu’une autre organisation de notre société est possible, est porteuse d’espoir. Le sujet est très technique mais la lecture d’« Émanciper le travail » permet d’y voir plus clair.
Ph.C.
1) « Loin de détruire la propriété, nous allons la généraliser comme propriété d’usage« .
2) « Qu’est-ce qui rend si difficile la propriété de l’habitat et quasiment impossible celle d’un habitat de qualité sinon son appropriation par le capital immobilier ?«
3) Les représentants de la classe ouvrière ont montré qu’ils étaient capables, de 1945 à 1960, d’exercer la co-propriété d’usage en gérant les caisses de sécurité sociale (les administrateurs en étaient élus et les trois quarts d’entre eux étaient des représentants des salariés). De Gaulle s’est empressé, dès qu’il l’a pu, de mettre fin à cette expérience trop réussie.
4) Le droit politique de tout citoyen, à partir de 18 ans, à une « qualification professionnelle« , supprimerait le chômage.
* * * * *
En savoir plus : Réseau Salariat
* * * * *
Discussion
Cet article a également été publié sur mon blog dans le « Club » de Mediapart. Il a donné lieu au commentaire suivant, de Richard Thévenon :
« Les « conquêtes sociales » de 1945 étaient ni sociales, ni anti-capitalistes. Les travailleurs n’y ont pris aucune part, et il s’agissait uniquement d’instaurer une gestion étatique social-démocrate, destinée à remettre en marche l’industrie et éviter toute révolution. Les plus radicaux de la classe ouvrière étaient armés, et il fallait à tout prix les désarmer, idéologiquement et politiquement. Ce qui est offert n’est jamais aussi solide que ce qui est pris, la Social Démocratie a été autant battue qu’elle a échoué.«
(Lien vers l’article de Richard Thévenon « Le macronisme comme fin de 72 ans de social-démocratie« )
Ma réponse à R. Thévenon :
« J’ai lu votre article de blog, je ne suis pas convaincu de votre approche. Quant aux conquêtes sociales de 1945, je ne suis pas historien, et j’ai des doutes sur ce que vous dites. Qu’est-ce qui peut l’étayer ? »
R. Thévenon répond :
« Je ne conteste bien entendu pas les « avancées » issues du programme du CNR, je pense d’ailleurs qu’ils n’avaient pas d’autre choix, raisonnable, que de passer par une voie étatique pour les imposer. Mais quand on se jette dans un piège, le plus dur est d’en sortir. Introduire l’État dans les contradictions sociales conduit à coup sûr à les dévoyer.
Aujourd’hui les employeurs parlent « d’impôt » et de « charges », alors qu’il ne s’agissait que d’utiliser la force publique pour leur faire cracher ce qu’ils devaient pour le travail et pour l’utilisation gratuite des infrastructures physiques et immatérielles.
Les acteurs sociaux sont devenus des « prestataires de service », et ils sont désormais jugés sur leur « rentabilité ». Pourquoi payer une cotisation syndicale, si le service rendu est assuré et gratuit ? Il n’y a plus de rapport évident et visible entre les prestations et la solidarité de tous. Voilà le résultat à terme de cette stratégie, dont personne n’a voulu sortir. Macron termine ce cycle.«
Ma réponse :
« D’accord sur le fait que s’en remettre à l’État est un piège, dans la mesure où il n’est pas maîtrisé par les citoyens. C’est vrai dans le système capitaliste, ça l’est aussi dans les systèmes communistes que nous avons connus.
Quant à la stratégie, celle de passer par l’État est aujourd’hui loin de notre portée ; celle de se passer de l’État l’est encore davantage, nous sommes loin, par exemple, de la situation de l’Espagne en 1936 du fait de la faiblesse des syndicats, partis et autres mouvements susceptibles d’évoluer vers cette approche. »
R. Thévenon :
Voir : « A Zaragoza o al Charco« , sur la gloire et la décomposition simultanées de la CNT en 1936-37. Avoir un syndicat Révolutionnaire, et souvent hégémonique, qui trois mois avant le coup d’État proclame le Communisme Libertaire, comme but et moyen, ne garantit pas grand chose non plus.
Publié : 22 novembre 2017 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Social | Tags: Fiodor Gladkov, Glieb Chumalov, Le Ciment, NEP, Réalisme socialiste, Révolution russe |
Publié en 1925, ce roman décrit d’une manière crédible, empreinte d’humanité et toute en nuances, la situation de l’Union Soviétique vers 1922 : la guerre civile, la famine, les débuts de la Nouvelle Politique Économique. Tout en exaltant les combattants de l’Armée Rouge et les « héros du travail », il ne craint pas de critiquer la bureaucratie aveugle dont fait parfois preuve le Parti.

En promouvant, à partir de 1932, en littérature et dans les arts, le « réalisme socialiste« , le pouvoir communiste en URSS voulait que soit représentée « de manière exemplaire, la plus figurative possible, dans des postures à la fois académiques et héroïques, la réalité sociale des classes populaires, des travailleurs, des militants et des combattants. »
Fiodor Gladkov est l’une des figures littéraires du réalisme socialiste. Il a été distingué dans ce sens par le Prix Staline en 1949 et 1951. « Le Ciment« , l’un de ses premiers romans, tout en se situant dans le réalisme socialiste avant l’heure, reflète une vision objective de la réalité dans laquelle se situe l’action. Par la suite, Gladkov réécrira certains passages de ce roman, certainement pour se mettre en conformité avec l’évolution de la ligne officielle. Lorsqu’il a écrit la première version, l’auteur a sans doute bénéficié d’une certaine liberté que permettait cette période de transition politique. Le grand succès de l’œuvre auprès du public témoigne de sa proximité avec les préoccupations de ses contemporains.
L’action se situe dans une ville portuaire (non identifiée) de la côte nord-est de la Mer Noire, entre la Crimée et la Géorgie, vraisemblablement en 1922, après les débuts de la NEP (Nouvelle Politique Économique) en 1921 et vers la fin de la guerre civile. Lénine (mort en 1924) était encore à la tête du pays.
Gladkov, à travers son roman, émet, sans en avoir l’air, un double message : la révolution passe avant tout parce-qu’elle est l’avenir du peuple russe ; mais les circonstances de ce moment historique sont particulièrement dures pour la population qui souffre de la violence des événements mais aussi du comportement bureaucratique du pouvoir.
L’auteur décrit avec détail les effets sur les Russes de la guerre civile contre les « blancs » (1) mais aussi contre les « verts » (2). La population, malmenée par les combats, souffre aussi de la famine. A cela s’ajoutent la désorganisation politique, le pillage des biens publics et privés, les réquisitions des récoltes, l’épuration, les exécutions sommaires et la torture (dans un camp comme dans l’autre). L’arrivée de la NEP relance un peu l’économie mais crée des inégalités et de l’enrichissement personnel. Le pouvoir communiste est dépeint de façon nuancée : il y a les dirigeants pleins d’abnégation et proches des gens mais il y a aussi des bureaucrates, froids et incompétents, autoritaires, violents voire violeurs.
Sous ce lot de misères, les gens du peuple sont broyés. Gladkov oppose les puissants aux gens simples, il montre les privilèges des premiers, et la misère des autres. Il appelle implicitement à l’empathie pour ceux-ci, qu’ils soient communistes convaincus, mencheviks, anciens cosaques, ou qu’ils aient aidé les verts.
Le personnage principal, Glieb Chumalov, est décrit à la fois en héros communiste (décoré de l’Ordre du drapeau rouge au combat et distingué comme « héros du travail ») et en citoyen ordinaire, dont l’humanité ressort à chaque instant. Communiste très engagé, il est montré en exemple par l’auteur pour affirmer que le combat pour la révolution doit passer avant toute chose, quoi qu’il arrive.
Mais ce combat n’a rien de stéréotypé. Si Glieb se bat, ce n’est pas pour un système théorique mais c’est réellement pour changer la société, au profit des plus fragiles.
Et puis en même temps qu’il le met en avant Gladkov relativise ce personnage. Comme d’ailleurs tous ses proches, Glieb est bousculé, déstructuré, par les contradictions de la situation politique. A la différence de bien d’autres, il poursuit la lutte parce-qu’il est particulièrement fort et désintéressé.
Un autre personnage important est Datcha, la femme de Glieb. Elle aussi communiste très engagée, elle symbolise la femme nouvelle, libre, tout en consacrant sa vie à la révolution. A tel point qu’elle néglige son mari, à qui elle reproche sa mentalité patriarcale, mais surtout sa fillette, qui finit par se laisser mourir par manque d’affection maternelle. Datcha est mue par le devoir mais on en voit le résultat. Gladkov, toutefois, ne juge à aucun moment et il montre les multiples facettes de chaque personnage.
« Le Ciment« , marqué par une grande humanité, est tout sauf un livre de propagande. Malgré son ton parfois édifiant et épique, il témoigne avec objectivité de la vie des gens simples dans le tourbillon de cette époque et il montre que la distance est courte entre la déchéance humaine et l’héroïsme, entre le « chacun pour soi » et le don de soi.
Il est difficile de trouver « Le Ciment » dans sa version française (traduction de Victor Serge en 1928). On le trouve plus facilement en anglais ou en espagnol (Editorial Cenit, 1928).
Ph.C.
1) Les armées tsaristes, parmi lesquelles, dans la région qui nous intéresse, des Cosaques.
2) Armées paysannes luttant contre les réquisitions de leurs cultures ou encore l’armée de Makhno en Ukraine. Les verts se sont à certains moments alliés aux rouges contre les blancs.
* *
Lire l’article de l’écrivain et homme politique péruvien José Carlos Mariategui (1929) sur « Le Ciment » (en espagnol).

Publié : 4 septembre 2017 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Bien public, Mondialisation, Vie citoyenne | Tags: Arcanie, Biens fondamentaux, Emmanuel Dockès, Société, Voyage en Misarchie |
En ces temps de désenchantement et de résignation devant la soi-disant fatalité néo-libérale, inégalitaire et porteuse d’austérité, le livre d’Emmanuel Dockès, « Voyage en Misarchie », montre que la capacité à imaginer une autre société n’est pas perdue pour tout le monde.
« Voyage en Misarchie. Essai pour tout reconstruire », Emmanuel Dockès, Éditions du Détour, mars 2017.

Sur un ton badin, l’auteur nous transporte dans un pays inconnu, l’Arcanie, où son héros atterrit suite à un accident d’avion. Ce personnage aura beaucoup de mal à s’adapter à cette contrée dont les coutumes diffèrent fortement des nôtres. Sur cette trame amusante nous allons à la découverte d’un autre monde, et de surprise en surprise.
Les premières mésaventures du héros ont trait au thème de la sexualité. Histoire de nous faire comprendre que la tolérance et le respect de la liberté individuelle sont le principal tabou de la société arcanienne. On peut discuter de tout, sauf de ces principes.
On comprend vite que le système économique de l’Arcanie a banni la propriété capitaliste et a instauré l’accès de tous aux biens fondamentaux.
Bien sûr, l’État a disparu (Misarchie = horreur du pouvoir). Il est remplacé par divers niveaux de pouvoir, aux mains des citoyens. Les principaux sont les « districts solidaires », qui gèrent les biens fondamentaux comme la santé et l’éducation, et les districts simples, entités territoriales qui peuvent gérer l’eau potable d’un bassin versant, un immeuble, voire un ascenseur. Ce sont les citoyens qui décident de créer un district, en fonction de leurs besoins et de la réalité locale.
Le tout est, on l’a compris, fortement décentralisé et autogéré. Et en constante évolution.
Ces structures sont gérées par les citoyens, soit en assemblée de tous les usagers lorsque la structure reste modeste, soit, pour les structures plus importantes par des assemblées en partie élues, en partie tirées au sort.
La santé, l’éducation, les communications (internet…), la sécurité sont gratuits. Certains services publics (comme le transport) sont payants mais fortement subventionnés. Il y a bien sûr des impôts pour financer tout cela.
La suppression de la propriété sur les biens immeubles interdit toute forme de domination : impossible d’exploiter des salariés en possédant une grande entreprise, impossible d’exploiter un locataire en lui louant un appartement ou une terre. La petite entreprise individuelle reste possible, l’esprit d’entreprise est donc sauvegardé, mais avec des garde-fous, le pouvoir revenant progressivement à l’ensemble des salariés. Il y a aussi des sortes de coopératives, où l’autogestion est totale (contrairement à nos coopératives agricoles, devenues de grands groupes capitalistes).
Tout comme la propriété, le travail est partagé, le temps de travail de base étant de 16 heures hebdomadaires, avec une large place laissée aux loisirs.
Chacun a bien sûr accès au logement mais celui-ci n’est pas transmissible aux enfants. L’héritage reste possible pour de petites sommes ou des biens d’une valeur limitée.
La monnaie est entièrement informatisée, avec une transparence totale permise par un contrôle strict par des représentants des citoyens. Pas possible de spéculer, de blanchir l’argent sale ou de s’évader dans les paradis fiscaux.
La société arcanienne reste ouverte : les immigrants sont accueillis avec générosité, on leur donne les moyens de subsister dignement et de s’intégrer rapidement, avec les mêmes droits que les Arcaniens de longue date.
L’auteur n’impose pas ce modèle sans débat. Il compare, à travers les avis des différents personnages, la société arcanienne à la nôtre (ce qui au passage souligne les inégalités criantes de cette dernière) et soupèse les arguments pour ou contre par exemple sur la liberté d’entreprendre, le revenu universel, la prise en charge de la délinquance, le contrôle citoyen…
L’auteur nous rassure : tout cela fonctionne… mais il a fallu des siècles d’évolution aux Arcaniens pour parvenir à ce système, qu’ils jugent d’ailleurs bien imparfait.
Alors, au travail !
Ph.C.
* * * * *
Emmanuel Dockès, professeur de droit à l’Université Paris-Ouest Nanterre, a coordonné « Proposition de Code du travail », qui réduit des trois quarts le volume du Code du travail tout en assurant un niveau de protection supérieur pour les salariés.
En savoir plus : Editions du Détour.
Publié : 4 août 2017 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Bien public, Initiatives citoyennes, Social, Vie citoyenne | Tags: Aporrea, Caracazo, Chavisme, Ciccariello Maher, communes, conseils communaux, Démocratie directe, Guérilla, Hugo Chavez, Lénine, Lopez Maya, Nicolas Maduro, Révolution, Révolution bolivarienne, Rodrigo Mora, Saintupery, Venezuela |
La « révolution bolivarienne », impulsée au Venezuela à partir de 1999 par Hugo Chavez et son entourage, vit vraisemblablement ses derniers moments. Difficile de dire ce qu’il en restera, mais on peut s’interroger sur ce qu’elle a été : s’agit-il d’une vraie révolution ?
Pour tenter de répondre à cette question, je vous propose deux articles et une synthèse de deux livres. Des approches différentes, mais qui se complètent et pourront s’ajouter aux informations que vous avez déjà ou que vous trouverez par ailleurs.
*
« Dérive autoritaire mafieuse »
Un article récent (1er/8/2017) sur le blog de Saintupery (Club de Mediapart), intitulé « Le chavisme dissident dénonce la « Néodictature » et appelle à la résistance« , aborde le contexte actuel de la situation au Venezuela, qu’il qualifie de « dérive autoritaire mafieuse de Nicolas Maduro et du mouvement bolivarien ».
Lire cet article.
*
« Une non-révolution »
Aussi radicale est l’analyse de Félix Rodrigo Mora publiée le 13/07/2017 sur son blog « Esfuerzo y Servicio Desinteresados ». Pour cet auteur espagnol, la révolution bolivarienne n’a rien d’une révolution, parce qu’elle vient d’en haut mais aussi parce qu’elle reproduit simplement, dit-il, les mécanismes du système capitaliste.
Lire cette analyse : FRM Venezuela Dar explicaciones
* * * * *
Chavez entre deux feux : les révolutionnaires et les chavistes conservateurs
Dans deux de ses livres, l’auteur américain George Ciccariello Maher met l’accent sur le point de vue des gens d’en bas et des révolutionnaires vénézuéliens qui, selon lui, ont donné l’impulsion au mouvement dirigé par Hugo Chávez, l’amenant régulièrement à se radicaliser.
Les chavistes de base : « Chavez, c’est nous qui l’avons créé »

Le premier de ces livres, c’est « La révolution au Venezuela. Une histoire populaire », traduit en français en 2016 (Ed. La Fabrique) mais publié originellement en anglais en 2013. Le titre anglais, « We created Chavez » (nous avons créé Chavez), est très signifiant.
George Ciccariello Maher montre qu’en effet l’élection d’Hugo Chavez en 1998, qui fait suite à ses deux coups d’États manqués de 1992, n’est que la continuation d’un long mouvement de révolte populaire des Vénézuéliens. L‘un des premiers jalons de cette histoire de révoltes est l’opposition, à partir de 1958, au régime de démocratie formelle dirigé par Rómulo Betancourt après la chute de la dictature de Marcos Pérez Jiménez. C’est à cette époque que démarrent des mouvements de guérilla.
Suite à l’échec de la guérilla, que G. Ciccariello Maher attribue à un « avant-gardisme » sans lien avec les masses, les leaders révolutionnaires se rapprocheront de celles-ci, notamment, dans les années 60 et 70, par la création de petits partis et de « fronts de masse » semi-légaux (ouvriers, étudiants) liés aux mouvements clandestins.
On note aussi, à cette époque, la résurgence du bolivarisme, comme réappropriation d’une tradition révolutionnaire nationale incarnant les luttes anti-impérialistes et non dénuée de fétichisme par rapport au personnage de Simon Bolívar.
En 1989 survient le « Caracazo », nom donné à une semaine d’émeutes contre les réformes néo-libérales de Carlos Andrés Pérez. Ces émeutes furent très durement réprimées (plusieurs centaines voire milliers de morts). Mais cela n’empêcha pas la poursuite de la résistance des Vénézuéliens, en particulier les habitants des quartiers pauvres de Caracas (les « barrios ») : on voit, dans ces barrios, émerger des organisations autonomes, assemblées autogérées et groupes d’auto-défense armée, contre le marché de la drogue et pour un travail d’éducation populaire (organisation d’activités sportives, culturelles et de loisirs).
Ces groupes de résistance armée se sont maintenus sous le chavisme (« los colectivos »), de même que les assemblées autogérées. Pour G. Ciccariello Maher, « la pression populaire a fait avancer le processus bolivarien ». Elle l’a aussi défendu, en particulier lors du coup d’État manqué contre Chavez en 2002. Chez ces gens d’en-bas, dit l’auteur, il y avait une relative confiance dans Chavez, mais pas dans son entourage bureaucratique, voire corrompu, qui le freine ; pour certains, « il y a Chavez et le processus révolutionnaire, qui permet si besoin d’aller plus loin que Chavez ». De même, les luttes des femmes, des étudiants, des Afro-vénézuéliens, des indigènes et des paysans « ont poussé Chavez vers la gauche ».
Dans sa conclusion, G. Ciccariello Maher, faisant référence à Lénine, estime que « la révolution nécessite une accumulation de pouvoirs » populaires, née de la convergence des luttes « avant de déconstruire l’État » pour le remplacer par un demi-état prolétarien (bourgeois et ouvrier à la fois) destiné à s’éteindre. « Les deux piliers de la bourgeoisie, la bureaucratie et l’armée, doivent être remplacés par des structures contrôlées par le peuple ». Au Venezuela, les milices d’auto-défense nées de la guérilla et les assemblées de quartier autogérées peuvent se situer dans cette logique. Le pouvoir chaviste a appuyé les unes et les autres : la loi organique des forces armées, en 2009, prévoit la mise en place de milices populaires, destinées à remplacer l’armée de métier ; en 2010, les communes sont officialisées.
Si l’extrême gauche pense trouver un allié en Chavez, celui-ci reste bridé par la bureaucratie de l’État central et des exécutifs locaux, qui pratiquent l’inertie pour protéger leurs privilèges. « L’appareil d’État vénézuélien concentre un mélange détonnant de guérilleros et d’opportunistes, de décentralisateurs authentiques et de nouvelles élites vêtues de rouge et assoiffées de pouvoir… »
La disparition de Chavez, en mars 2013, porte un coup d’arrêt « à son rôle d’unification du processus bolivarien ». Au moment où est écrit le livre, « il reste la constitution (de 1999) et l’idée révolutionnaire qui la sous-tend », il reste aussi, même après sa mort, la fonction unificatrice de Chavez, « à moins qu’il soit transformé en souvenir historique ».
La commune en construction : chantier compromis

Le deuxième livre, en anglais, « Building the commune. Radical democracy in Venezuela » (La commune en construction. La démocratie radicale au Venezuela), Éditions Verso, 2016) met l’accent sur les conseils communaux et les communes, mis en avant par Hugo Chavez peu avant sa mort, dans son discours dit « El golpe de timón » (le coup de gouvernail, 20/10/2012), où il parle « d’État communal », traçant en quelque sorte la voie.
Mais ces conseils communaux et ces communes viennent de loin. Ils sont la suite des assemblées de quartier autogérées, mises en place par l’initiative populaire. Les lois chavistes sur les communes (2006 et 2010) ont été peu appliquées, du fait de la résistance bureaucratique, mais on a compté jusqu’à 45 000 conseils communaux et 1 500 communes, la pression populaire les faisant avancer malgré tout.
Ces lieux de démocratie directe réunissant les habitants recouvrent des formes très diverses. Certains produisent, des biens alimentaires, des vêtements, des logements, organisent la distribution de ces biens… Ils créent des stations de radio. Ils font en sorte de répondre aux besoins de la population, se soucient de durabilité.
Aux antipodes de la vision de George Ciccariello Maher, on trouve celle de Margarita López Maya, écrivaine vénézuélienne, pour qui les conseils communaux, sous un couvert de démocratie directe, sont une façon pour le chavisme de centraliser le pouvoir entre les mains du président. Les moyens financiers des conseils communaux viennent d’en haut. M. López Maya ignore la dynamique autonome de ces instances, que G. Ciccariello Maher met en avant. Sur ce point, le débat reste ouvert.
Avec la mort de Chavez, la situation change. Selon G. Ciccariello Maher, si « Chavez marchait sur le fil entre les bases populaires et l’État », depuis, le mécanisme dialectique a du mal à fonctionner ; Nicolás Maduro, en prise avec les difficultés économiques et avec l’opposition, accuse souvent l’extrême gauche d’irresponsabilité. « Il ne voit pas que ce ne sont pas les Jacobins » (l’exécutif autoritaire) « qui sauveront la révolution bolivarienne mais les sans-culottes » (le peuple).
« Le choix (pour l’avenir) est entre la commune et le néant », dit G. Ciccariello Maher. Sans illusion vis-à-vis de l’opposition « qui fait tout pour rétablir le système réactionnaire favorable à l’oligarchie », il reste lucide quant aux causes de l’échec de la révolution bolivarienne : crise économique liée à la dépendance quasi-totale au pétrole et incapacité à développer d’autres secteurs (notamment l’agriculture), système rigide de contrôle monétaire ayant entraîné le marché noir et la spéculation, corruption économique privée et étatique, désorganisation des services publics…
Conscient de cette réalité, le peuple vénézuélien s’est exprimé lors des échéances électorales, d’abord en s’abstenant fortement puis en votant majoritairement pour l’opposition. Le pouvoir, lui, pratique la fuite en avant et, face aux revers électoraux, tente de tordre la démocratie en manipulant les institutions. La réponse de l’opposition, privée de possibilité d’agir à l’Assemblée Nationale, est dans la rue. Jusqu’où ira la violence, dans laquelle tant la droite que le régime ont leurs responsabilités, et à qui profitera-t-elle ? Pour l’instant, la sortie de crise n’est pas en vue.
Ph.C.
* * * * *
En savoir plus :
George Ciccariello Maher.
Voir sur le site chaviste Aporrea les articles de Roland Denis et Nicmer Evans.
Félix Rodrigo Mora.
Publié : 6 juin 2017 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Biodiversité | Tags: Arbres, Biodiversité, Connexions racinaires, Ecosystème, Eifel, Epicéa, Forêt, Forêt primaire, Futaie jardinée, Hêtraie, Messages odorifères, Peter Mohlleben, Pin, Sylviculture, Vie secrète |
L’auteur, forestier dans le massif allemand de l’Eifel, nous explique comment les arbres s’adaptent à leur milieu, échangent des informations et font preuve de solidarité. Un récit passionnant.
« La Vie Secrète des Arbres. Ce qu’ils ressentent, comment ils communiquent », de Peter Wohlleben, Éditions Arènes, 2017.

A travers son métier de forestier, Peter Wohlleben observe depuis vingt ans les arbres de sa région. Dans ce livre paru début 2017 il décrit l’intelligence des végétaux et leur adaptation à leur environnement. Dans les conditions de la forêt primaire (par opposition à la forêt cultivée, très artificialisée), explique-t-il, les arbres d’une même espèce adoptent une stratégie commune de survie ; la forêt qu’ils constituent est un écosystème où les conditions forestières (ombrage, abri du vent et du froid, humidité, sol…) sont optimales.
Mais la stratégie d’ensemble se double d’une sorte d’entraide entre les arbres : alors que les individus d’espèces différentes se disputent l’accès à la lumière et aux ressources du sol, les arbres d’une même espèce échangent des substances nutritives par leurs racines, avec l’aide des réseaux de champignons, compensant ainsi mutuellement leurs faiblesses et leurs forces pour venir en aide aux plus faibles.
Peter Wohlleben expose d’autres particularités des arbres. Ils ont un langage, par l’émission d’odeurs pour prévenir une attaque d’insectes, et peut-être aussi par l’émission d’ondes sonores. L’auteur se demande si les plantes ont un cerveau. En tout cas, elles sont capables de retenir des informations et de s’adapter en conséquence. Par exemple, les arbres apprennent à modérer leur consommation d’eau en prévision d’une possible sécheresse ; ou encore ils savent, à partir de l’évolution de la durée du jour et des températures, que le printemps est là, et ils déclenchent en temps utile le développement de leurs bourgeons.
Ce livre contient par ailleurs une foule d’informations détaillées sur la biologie des arbres : l’alimentation en eau, le rôle de l’écorce, la stratégie de l’épicéa pour résister au poids de la neige (les branches s’inclinent jusqu’à se superposer comme des tuiles et se soutiennent les unes les autres), l’interaction avec les animaux et la microfaune du sol…
On comprend comment les conditions de la forêt artificielle s’éloignent de celles de la forêt naturelle. Dans celle-ci, les arbres poussent très lentement, ce qui est un gage de longévité et de résistance (ils vivent en moyenne jusqu’à 400 ou 500 ans pour les hêtres) ; dans celle-là, la sylviculture favorise une croissance rapide, d’où des arbres plus fragiles (fragilité accentuée par le fait qu’ils ont tous le même âge). Pour cela elle pratique les éclaircies, qui favorisent les sujets les plus robustes mais fragilisent l’écosystème.
Est-il possible de retourner à la forêt primaire, demande Peter Wohlleben ? En Allemagne, les pouvoirs publics ont décidé de ne plus intervenir sur au moins 5 % de la surface forestière. Et on observe une évolution rapide avec notamment un dépérissement des épicéas et des pins, plantés dans des régions trop chaudes et trop sèches pour eux, qui sont vite ravagés par les insectes. Les feuillus prennent alors le dessus. Il faut, dit l’auteur, 200 ans à une forêt de feuillus et 500 ans à une forêt de conifères pour revenir à l’état naturel.
Il compare le statut des arbres avec l’évolution du statut de l’animal, auquel la loi reconnaît désormais une sensibilité. Et il appelle à respecter les arbres en tant qu’êtres vivants, à ne pas puiser plus que nécessaire dans cette ressource, et à les exploiter dans des conditions qui respectent leur fonctionnement et leurs besoins. C’est le principe de la futée jardinée, où les interventions sont douces, avec des coupes légères et fréquentes, et débardage au cheval… « La futée jardinée est à l’exploitation forestière ce que l’agriculture biologique est à la production de denrées alimentaires. Cette méthode de gestion durable de la forêt mêle étroitement les arbres de tailles et d’âges différents, si bien que les enfants arbres grandissent sous leur mère… »
Peter Wohlleben invite notre société à aller plus loin dans la connaissance des capacités cognitives, de la vie sensorielle et des besoins des arbres, histoire de mieux les connaître et mieux les respecter.
Ph.C.
* * * * *
Lire aussi, sur ce blog, sur la hêtraie des Albères (Pyrénées-Orientales), « La Massane, une forêt témoin à l’état naturel« .
Et, sur l’importance de la forêt pour les communautés paysannes au Moyen-Âge, « Une révolution : désindustrialiser et désurbaniser pour (r)établir une société rurale et un environnement équilibrés« .
* * * * *
Les Editions Les Arènes viennent de faire paraître (2018) un autre livre de Peter Wohlleben, « La Vie Secrète des Animaux ». Il s’appuie lui aussi sur les nombreuses observations de ce forestier proche de la nature.
Publié : 16 décembre 2016 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Social, Viticulture | Tags: 1907, CNRS, Femmes, Jean-Louis Escudier, Lameta, Luttes syndicales, Ouvrières, viticulture, XIXe, XXe |
Les femmes ont longtemps été utilisées comme journalières en viticulture pour leur faible coût et leur flexibilité. Mal payées (au « demi-salaire »), cantonnées dans les tâches soi-disant non qualifiées, employées plus occasionnellement que de manière permanente, elles n’ont jamais réellement accédé à un statut à part entière. Jean-Louis Escudier a étudié cette réalité de près sur la période des XIXe et XXe siècles.
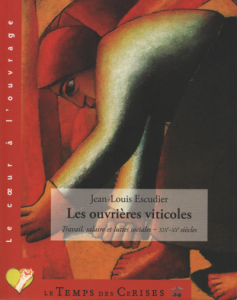
La plupart des historiens, lorsqu’ils évoquent la condition des femmes ouvrières, se polarisent sur l’industrie ou la domesticité, ignorant les ouvrières agricoles. De même, lorsqu’on parle des femmes en agriculture, on parle généralement des épouses d’exploitants, très rarement des ouvrières agricoles. L’ouvrage de Jean-Louis Escudier, « Les ouvrières viticoles. Travail, salaire et luttes sociales – XIXe-XXe siècles » (Éditions Le Temps des Cerises, 2016) rend justice, à travers une étude très fine, à celles qui ont tenu une grande place dans les travaux de la vigne depuis son expansion, au milieu du XIXe siècle, jusqu’au siècle suivant.
Chargé de recherche au CNRS (Lameta, Université Montpellier 1), Jean-Louis Escudier développe un programme de recherche visant à mieux comprendre les dynamiques de long terme entre le travail et le capital. Dans le sujet de recherche qui est à l’origine de ce livre, il centre son étude sur les ouvrières viticoles, dans l’ensemble des régions de production françaises. L’agriculture, dit-il, est un terrain fertile pour qui souhaite confronter rapports de genre et rapports salariaux ; et la viticulture tout particulièrement dans la mesure où elle a vécu une transformation radicale en une génération, à partir des années 1850 : expansion du marché du vin avec l’arrivée du chemin de fer, puis reconstruction du vignoble suite à la crise phylloxérique.
Le premier chapitre (1860-1914 : la salariée viticole, une travailleuse indispensable) montre que, dans la division sexuée du travail, l’emploi féminin est fortement infériorisé, à tel point que les ouvrières n’apparaissent pas dans les statistiques et registres. Elles sont pourtant bien présentes dans le vignoble mais leur travail n’est pas reconnu, donc passé sous silence.
Aux hommes le travail « qualifié », aux femmes les travaux pénibles
Dans cette période déjà, alors que les tâches qualifiées sont réservées aux hommes, les femmes sont utilisées comme main-d’œuvre moins chère, corvéable à merci et « non qualifiée ». Le greffage est réservé aux hommes, les femmes sont affectées à la greffe sur table en pépinière (plus automatisée et aux cadences exigeantes) ; ce sont les hommes qui taillent mais les femmes qui ramassent les sarments ; les hommes portent les pulvérisateurs à dos, les femmes les approvisionnent en eau ; les femmes coupent le raisin, les hommes portent la hotte ; les femmes sont tenues à l’écart de l’élaboration du vin mais elles rincent les bonbonnes et les bouteilles, posent les étiquettes et emballent.
Et paradoxalement, lorsqu’on choisit les femmes pour réaliser un travail délicat, comme le tri et le ciselage des raisins de table, on ne les considère pas pour autant comme effectuant un travail qualifié et elles restent sous-payées.
Quand arrive une certaine mécanisation, à la fin du XIXe (charrues tractées, broyeurs de sarments), c’est l’homme qui manie la machine et la femme qui effectue le travail manuel.

Les femmes, de manière générale, sont affectées aux travaux intermittents, saisonniers, on les utilise pour leur flexibilité (non choisie), dans les travaux et les postures les plus pénibles, et on les paie bien moins que les hommes : jusqu’au milieu du XXe, la règle pour les femmes est le « demi-salaire » (la moitié du salaire des hommes les moins qualifiés).
Par ailleurs, les femmes sont désavantagées dans le domaine social : les premières mutuelles sont exclusivement masculines (jusqu’en 1898) et elles ne couvrent que le cotisant, pas ses ayant-droit (jusqu’en 1930). Les retraites désavantagent les femmes : elles cotisent peu (petits salaires, temps partiel) et touchent encore moins, proportionnellement. En l’absence de congés maternité, les mères travaillent le plus longtemps possible jusqu’à l’accouchement et tout de suite après.
L’ostracisation du travail féminin n’est pas que le fait des patrons. La mentalité masculine en est fortement imprégnée, y compris dans les mouvements politiques et syndicaux. Le mouvement socialiste évoque bien, dans les discours, les rapports économiques de genre, mais il ne les traduit pas dans les revendications ni les luttes. D’une part, le statut économique et social des salariées agricoles est méconnu, d’autre part il y a des réticences par rapport à l’emploi salarié des femmes rurales ; cela parce que l’on considère que la place de la femme est au foyer mais aussi parce que l’on estime que le salaire masculin doit suffire à nourrir la famille.
Dans le mouvement syndical, alors que les femmes s’impliquent souvent, peu de place est accordée à leurs revendications spécifiques et elles sont encore moins partie prenante des négociations entre syndicats et employeurs.
La guerre de 14 marque un tournant, qui ne changera pas fondamentalement la situation des ouvrières viticoles (2e chapitre : « 1914-1945 : la salariée viticole oubliée du progrès social« .
Certes, la guerre bouscule les rapports sociaux de genre. Les hommes étant mobilisés, les femmes les remplacent, s’impliquant largement dans la marche des exploitations ; elles font le travail des hommes, mais pour des salaires de femmes. Et avec le retour de la paix, chacun reprend sa place.
Les ouvriers de l’industrie voient quelques progrès dans leurs revenus et conditions de travail (hausse des salaires en 1913, baisse du temps de travail en 1919) mais l’agriculture ne suit pas le rythme.
Il faut attendre le Front Populaire pour voir des avancées qui concernent aussi l’agriculture, comme les congés payés (12 jours ouvrables en 1936). Les conventions collectives (1937) prévoient la baisse du temps de travail, mais leur extension (qui rend leur application obligatoire par tous les employeurs) est très lente en agriculture.
Pour parer à l’exode rural, on préfère mettre en place le salaire indirect que représentent les allocations familiales agricoles qu’augmenter les salaires.
Et la mécanisation, qui se renforce, reste réservée aux hommes ; elle n’est pas utilisée pour réduire la pénibilité du travail féminin.
L’augmentation de la syndicalisation avec le Front Populaire aboutit à une timide prise en compte de la condition des ouvrières agricoles.
Peu à peu remplacées par la machine
La loi du 11/02/1950 (3e chapitre : « 1945-1980 : un emploi viticole féminin toujours précaire« ) marque un net changement concernant les salaires puisqu’elle établit la parité entre hommes et femmes pour le salaire minimum. Mais les emplois féminins régressent avec la montée de la mécanisation : entre 1950 et 1980, le temps de travail annuel nécessaire à la culture d’un hectare de vigne est divisé par trois. L’augmentation du salaire féminin est aussi certainement une des raisons d’un moindre recours aux femmes pour les travaux viticoles. La cueillette des raisins (vendanges et raisin de table) reste l’un des derniers bastions du travail féminin.
La généralisation des allocations familiales (dont l’allocation de salaire unique) concourt elle aussi au recul de l’emploi féminin, en ramenant la femme dans son foyer.
L’égalité hommes-femmes sur les grilles salariales, pour sa part, n’arrivera qu’en 1972. En 1974, les 40 heures sont appliquées tardivement aux salarié(e)s agricoles mais avec encore des dérogations… et des heures non déclarées.
Sur le plan syndical, à la Libération les femmes sont généralement admises dans les syndicats mais elles accèdent peu aux postes de responsabilité, bien qu’elles soient très présentes et combatives dans les grèves. Avec les crises viticoles et la mécanisation, le rapport de forces est de plus en plus défavorable aux salariés, et aux femmes encore plus.
Dans les années 1980, alors que les salariées viticoles sont de moins en moins nombreuses et malgré le salaire minimum pour tou(te)s, leur précarité salariale, le temps partiel, la flexibilité persistent comme persistent les discriminations à l’embauche, la non reconnaissance de la qualification et l’absence de profil de carrière.
La condition des ouvrières viticoles pendant les deux siècles étudiés est certainement due à une conjonction de facteurs, comme l’exprime Madeleine Guigliardi en 1947 au Xe Congrès national de la FNTA (Fédération nationale des travailleurs de l’agriculture – CGT) à Bourges. « Les femmes sont plus durement exploitées que les hommes par le régime capitaliste« . Mais il y a aussi les mentalités qui ne reconnaissent pas l’égalité hommes-femmes, ce qui se traduit par exemple dans le domaine syndical : « En ce qui concerne l’égalité pour les femmes« , dit Madeleine Guigliardi, « malheureusement nous avons encore à lutter contre des camarades quelquefois ; comment voulez-vous que nous n’ayons pas à lutter contre les patrons ?«
Ph.C.
* * * * *
1907 : unanimisme de façade
L’auteur souligne « la surexposition médiatique des viticultrices dans la révolte de 1907 » : elles ont souvent été mises en avant, notamment pour illustrer la misère familiale due à la crise.
Et ce « mouvement interclassiste« , auquel les ouvriers agricoles ont largement participé, occulte pourtant, dans ses revendications et son discours, le statut des salariés viticoles.
Pourtant, comme le souligne en 1908 le syndicaliste François Cheytion, « les morts et les blessés (de 1907) ne se comptent que chez les ouvriers. Pendant les manifestations, les propriétaires manifestaient dans leurs salons, à l’abri des murailles de leurs châteaux« .
Une fois le calme revenu et les marges nettes d’exploitation restaurées, les revendications des ouvriers agricoles ne sont pas plus entendues qu’avant.
* * * * *
En savoir plus : Le Temps des Cerises.
Lire aussi, sur ce blog : « 1907, la Révolte du Midi ».
Publié : 20 novembre 2016 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Initiatives citoyennes, Vie citoyenne | Tags: Alberto Arricruz, Ciudadanos, Démocratie participative, Lola Banon, Podemos, Pouvoir, PP, PSOE |
« Nous avons décidé d’aller dans les institutions, au risque de se perdre, quelle autre solution avions-nous ? », dit Alberto Arricruz, expliquant la stratégie de Podemos. Ce mouvement a choisi de prolonger la mobilisation des Espagnols dans la rue depuis le 15 mai 2011 par un processus de conquête des institutions. Apparaît alors le risque que Podemos devienne un parti politique comme les autres…

Alberto Arricruz.
Lire la suite sur le blog des Ami.es de François de Ravignan.
Publié : 31 mars 2016 | Auteur : Philippe Cazal | Classé dans : Biodiversité | Tags: Albère, Argelès-sur-Mer, Biodiversité, Changement climatique, Forêt, Forêt Méditerranéenne, Forêt témoin, Hêtraie, Laboratoire Arago, Massane, Perthus, Réserve naturelle, Vache |
Une forêt de hêtres entre 600 et 900 m d’altitude, en plein climat méditerranéen, cela a de quoi surprendre (1). La Forêt de la Massane, dans le massif de l’Albère (commune d’Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales), serait, selon une hypothèse scientifique qui reste à confirmer, une forêt témoin de l’époque quaternaire qui se serait maintenue malgré la dernière glaciation (jusqu’à il y a 10 000 ans) (2).

La réserve naturelle de la Massane couvre 336 ha : une hêtraie entre 600 et 900 m d’altitude en climat méditerranéen.
Cette particularité et la présence, dans cette hêtraie, d’espèces reliques (de coléoptères notamment) justifient sa préservation, au moins comme objet d’étude, même s’il est impossible d’arrêter le temps et même si cette préservation est menacée par le changement climatique ou par la pollution.
Au-delà de son caractère de témoin, La Massane est intéressante par sa grande biodiversité, qui résulte notamment de son classement en réserve naturelle.
Précisons tout de suite que cette forêt n’a pas toujours été à l’état « naturel » (3). Elle a été exploitée du haut Moyen-Age jusqu’en 1860 environ. Au XIXe siècle, on retirait de ce massif du bois de chauffage, de la glu (à partir de l’écorce du houx) et surtout du charbon de bois (qui servait ensuite à alimenter les forges, pour fabriquer l’acier, et les verreries, dans la région proche). On trouve encore, à flanc de colline, les traces de charbonnières.
Le pastoralisme était également très présent dans le secteur. Juments, ovins, cochons, bovins y trouvaient leur nourriture. Aujourd’hui, seuls restent, dans le massif, quelques troupeaux de vaches.
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la surexploitation de la forêt et la forte pression pastorale avaient dégradé la couverture forestière de la haute-vallée de la Massane (4). A l’instigation de l’administration des Eaux et Forêts on a alors cessé l’exploitation afin de laisser les sols et la végétation se reconstituer.
La proximité du Laboratoire Arago, de Banyuls-sur-Mer, a fait de la haute-vallée de la Massane un lieu d’observation pour les scientifiques. Le classement en réserve naturelle des 336 ha de hêtraie, intervenu en 1973, a accentué le caractère de naturalité du lieu.
Un observatoire privilégié de la biodiversité
Aujourd’hui, La Massane est un rare exemple de forêt non exploitée, où les processus de vie et de mort se déroulent naturellement. D’où une grande biodiversité. Celle-ci est liée au milieu naturel lui-même (arbres, plantes, humus, rivière), qui favorise la présence de toutes sortes d’espèces végétales et animales. Mais aussi au dépérissement naturel des arbres qui, avec le bois mort, deviennent un refuge pour phytophages, champignons et insectes. Le bois mort est encore un terrain de chasse, un abri ou encore un support de nidification pour de nombreuses espèces.
Le milieu local a aussi une spécificité due à sa situation à la fois de carrefour biogéographique (au contact de l’Espagne et des sommets pyrénéens) et d’isolement (le massif est nettement coupé du reste de la chaîne pyrénéenne par le col du Perthus).
Ce milieu est un cadre d’étude très riche pour l’association des Amis de la Massane, qui gère la réserve, et pour des scientifiques partenaires. Ce qui a donné lieu à de très nombreuses publications.
L’un des supports d’étude est la cartographie des arbres (vivants et morts) d’une partie de la réserve (28 ha) réalisée par l’association, à partir de laquelle celle-ci effectue un suivi et mène un certain nombre d’observations.

Dans la forêt non exploitée, les processus de vie et de mort se déroulent naturellement. D’où une grande biodiversité, liée en particulier à la présence de bois mort.
Plusieurs inventaires sont réalisés ou en cours : avifaune, coléoptères, staphylins, fourmis…
Ces études permettent d’illustrer le degré élevé de biodiversité constaté localement mais aussi de montrer l’évolution des espèces et d’essayer d’en comprendre les causes : réchauffement climatique, pollution atmosphérique, pression des parasites et des prédateurs… L’étude de la dynamique du peuplement forestier, en relation avec les événements climatiques (canicule, vent) et la pollution vont dans le même sens.
Pour ce qui est de la pollution, elle est due à la proximité de la région barcelonaise mais aussi à la circulation aux abords du Perthus et sur le littoral à forte fréquentation touristique. On relève de fortes concentrations d’ozone en été.
La comparaison entre deux parties de la réserve, l’une ouverte au pâturage bovin, l’autre protégée de ce pâturage, montre un stock de plantules beaucoup plus important dans la partie protégée. Le pâturage et le stress estival semblent être les deux principaux facteurs limitants du développement des plantules.
Laboratoire à ciel ouvert, la réserve naturelle de la Massane permet d’étudier le comportement d’une forêt où l’intervention humaine est quasi-nulle (à noter toutefois le passage de quelque 25 000 randonneurs par an, dans la réserve ou à proximité).
Le constat principal des observations est bien sûr la présence d’une grande biodiversité, permise par ce caractère naturel.
La Massane, note l’association, est aussi un exemple de « ces ambiances forestières si authentiques (…, un) petit morceau de notre mémoire culturelle collective ». Loin de croire que toutes les forêts peuvent ressembler à celle-là et sans réduire la biodiversité à cet exemple, il faut reconnaître que ce genre de témoin permet de mesurer ce que nous perdons avec l’absence ou le recul de la biodiversité.
Ph.C. (Article paru dans le Paysan du Midi et L’Agriculteur Provençal du 24 juin 2011).
1) Il faut tempérer toutefois cet aspect : il pleut jusqu’à 1 200 mm par an sur les hauteurs de l’Albère (contre 700 environ à ses pieds) et la vallée de la Massane est souvent parcourue par un courant d’air froid.
2) Une étude du Laboratoire Arago et de l’Inra s’efforce d’établir la caractérisation génétique de la hêtraie afin de déterminer son origine et son lien éventuel avec les autres hêtraies des Pyrénées-Orientales.
3) On ne peut donc pas parler de « forêt primaire » même si la non-exploitation et la mise en réserve tendent au retour à une forêt primaire.
4) La Massane, fleuve côtier, se jette dans la Méditerranée à 22 km de sa source.
Concernant le débat entre forêt exploitée et forêt naturelle, lire sur ce blog l’article sur « La vie secrète des arbres », de Peter Wohlleben, Ed. Les Arènes, 2017.
Sur l’importance de la forêt dans nos territoires au Moyen-Âge, lire sur ce blog « Une révolution : désurbaniser et désindustrialiser pour (r)établir une société rurale et un environnement équilibrés ».
* * * * *
Au sommet : la biodiversité en milieu ouvert
La présence des vaches, souligne l’association des Amis de la Massane, est fondamentale pour le maintien du paysage des pelouses sommitales et des landes du massif de l’Albère. C’est un autre milieu, ouvert celui-là, une autre biodiversité. Cet élevage bovin extensif, témoin d’une activité ancestrale, est, explique l’association, « le résultat d’une longue expérience pour trouver l’équilibre fragile entre activité humaine et préservation de la nature ».
* * * * *

Pour préparer Foresterranée’11, l’association Forêt Méditerranéenne avait organisé réunions thématiques et visites de terrain. Ici, dans la forêt de la Massane.
Foresterranée 2011 : forêt méditerranéenne et biodiversité
Cet article était paru en préambule aux rencontres Foresterranée’11, que l’association Forêt Méditerranéenne organisait les 17 et 18 novembre 2011 à Saint-Martin-de-Crau sur le thème « Usages, biodiversité et forêt méditerranéenne ».
L’association Forêt Méditerranéenne, qui réunit des adhérents et des métiers très divers autour de la forêt, avait préparé ce colloque par des groupes de travail et des visites de terrain, dont l’une dans la Forêt de la Massane.
L’association expliquait, dans le n°83 de son bulletin La Feuille et l’Aiguille (mai 2011), que « la biodiversité est une notion complexe, un concept qui évolue (dans l’histoire, dans le temps et dans l’espace), qu’il convient d’éclaircir ».
« Les gestionnaires de forêt ont souvent une position d’autodéfense dès qu’il s’agit d’intégrer les questions de biodiversité ; ne gagneraient-ils pas à tirer parti de la biodiversité au lieu d’en subir les contraintes ? Face à un empilement de réglementations et à des « niveaux » de gouvernance variables suivant les territoires, comment mettre en œuvre les politiques, règles et dispositions législatives, pour appliquer au mieux le concept de biodiversité à la gestion du territoire ? »
Ph.C.














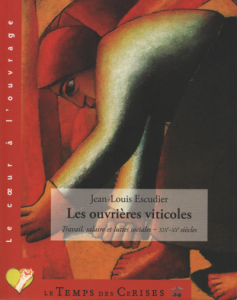

Commentaires récents