FELIX RODRIGO MORA…………………. Une révolution : désindustrialiser et désurbaniser pour (r)établir une société rurale et un environnement équilibrés
Publié : 21 mars 2016 Classé dans : Bien public, Vie citoyenne | Tags: Changement climatique, Communs, Conseils ouverts, Convivialité, Déforestation, Désurbaniser, Espace rural, Félix Rodrigo Mora, Franquisme, Mécanisation, Productivisme, Propriété collective de la terre, Régime des pluies, Reboiser, Société rurale, Stérilisation des sols Poster un commentaireDans « Naturaleza, ruralidad & civilización« , Félix Rodrigo Mora déplore l’asservissement de l’être humain par la société de consommation et la destruction de l’environnement par son artificialisation extrême. Pour en arriver là, il a fallu détruire la société rurale traditionnelle, centraliser, industrialiser. L’auteur propose une véritable révolution pour recréer une société sobre, conviviale et démocratique, en phase avec la nature. Il est temps, dit-il, de sauver à la fois l’humanité et la biosphère.
Félix Rodrigo Mora, « Naturaleza, ruralidad & civilización« (Éditions Brulot, 2008). En castillan.

En Espagne, comme ailleurs en Europe, la société a été essentiellement rurale jusqu’à la révolution industrielle. Cette société rurale traditionnelle était caractérisée par un mode de gouvernement local communautaire, par la propriété collective de la terre et de l’espace rural, et par un esprit de convivialité. Elle a fermement lutté contre son démantèlement progressif, mis en œuvre successivement par la monarchie centralisatrice, par le libéralisme et par le franquisme, qui ont fini par avoir en grande partie raison d’elle.
Après la période centralisatrice, urbanisée et autoritaire de l’empire romain, ce que Félix Rodrigo Mora appelle la révolution civilisatrice du Haut Moyen-Age est à l’origine de la société rurale traditionnelle, dans laquelle primaient la relation sociale, la recherche de l’harmonie au sein de la communauté locale. Il y avait alors, dit-il, une conception du monde qui donnait la priorité aux relations humaines, à l’aide mutuelle, avec un détachement relatif par rapport aux biens matériels.
L’auteur décrit le système des conseils ouverts où les décisions concernant la vie locale se prenaient en assemblées ouvertes à tous. Ces conseils étaient souverains au niveau local et avaient un pouvoir législatif et exécutif.
En même temps la communauté était propriétaire collectivement de la plus grande partie de l’espace rural, des pâturages, parcours, landes, garrigues, bois, ruisseaux… qui pouvaient être utilisés par l’ensemble des membres de la communauté tout en veillant à l’intérêt commun.
En Alava par exemple les conseils ouverts géraient le labour collectif, la répartition de parcelles entre les familles pour une durée déterminée, le soin des parcours et des bois, l’organisation du pâturage. Ils géraient aussi le travail communal, les fêtes, l’approvisionnement, les activités artisanales communes et l’éducation.
L’auteur consacre un chapitre à la fête populaire qui, jusqu’à une période très récente, avait plusieurs fonctions : se divertir, renforcer les liens humains et donner libre cours à la créativité. Lors d’une noce par exemple, une bonne partie des invités participait à tour de rôle, en poussant la chansonnette (qu’ils avaient souvent inventée eux-mêmes), en récitant un texte à l’intention des époux ou en constituant l’orchestre du bal. On se divertissait en créateurs de culture plus qu’en consommateurs, en acteurs plus qu’en spectateurs passifs. Et donc, à la différence d’aujourd’hui, en dehors du marché.
Cette société rurale traditionnelle, note Félix Rodrigo Mora, a eu toutefois un défaut fondamental : l’absence d’objectifs pour se dépasser, « l’inexistence d’une formulation sur le quoi, le pourquoi et le comment du demain que l’on souhaite ». Elle a donc d’autant plus facilement été détruite par l’État.
L’action « modernisatrice » méthodique du franquisme
Cette destruction a connu son achèvement sous le régime franquiste, dans les années 1950-60. Jusque là, la société rurale a notamment refusé obstinément la mécanisation de l’agriculture : dans les régions de latifundia du sud de l’Espagne, ce sont les brassiers qui s’opposaient à l’introduction des machines, jusqu’à, parfois, y mettre le feu ; dans le reste de l’Espagne, où dominaient les conseils ouverts et les terres communales, les paysans n’étaient pas intéressés par les machines.
Avec l’industrie naissante, la classe ouvrière avait conservé des liens étroits avec le monde pré-industriel (esprit communautaire, aide mutuelle, dédain pour le monétaire, délibération en assemblées…). On comprend la forte résistance populaire au coup d’état de 1936. Selon l’auteur ce sont d’ailleurs les paysans, plus que les ouvriers, qui ont le plus résisté au franquisme.
Malgré la résistance, l’ordre nouveau a été instauré. « Si l’on voulait créer un mouvement ouvrier domestiqué, consumériste, acceptant de mener une vie de porcs, il fallait extirper à la racine la société populaire traditionnelle, ce que fit le franquisme. » L’État franquiste a procédé méthodiquement, avec d’une part l’Office National du Blé, auquel il fallait livrer tout le blé commercialisable. On a incité la monoculture de céréales, ce qui était un moyen de rentrer dans le marché et la bancarisation. L’extension de l’irrigation, la mécanisation, les engrais, les pesticides ont accompagné une logique productiviste de monocultures.

Albarracin (province de Teruel). La stérilisation totale par la disparition de la végétation arborée, que ce soit sur les terrains plats, en monoculture de céréales, ou sur les collines. Photo Diego Delso, Lic CC By SA 3 0, Wiki Commons.
D’autre part, avec la création d’un organisme dénommé « Patrimoine forestier de l’État », on a continué à détruire la forêt traditionnelle autochtone en la remplaçant par des cultures et par des boisements artificiels de pins et d’eucalyptus.
L’intensification de la production agricole et la perte par les habitants ruraux de leurs moyens de subsistance liés à la forêt et à l’espace naturel ont entraîné un nouvel exode rural : entre 1950 et 1981, les communes de moins de 10 000 habitants ont perdu 5,3 millions d’habitants au profit des grandes villes.
« On a une fausse image du franquisme », dit Félix Rodrigo Mora : On le présente comme « un conglomérat de phalangistes, de curés et de militaires ignorants ». Il avait en réalité un programme technique, économique et politique très élaboré, dans une optique technocratique, productiviste et consumériste.
Il s’est acharné sur la société rurale traditionnelle, l’a dénigrée en la faisant passer pour « arriérée », et n’a eu de cesse de voir détruit le patrimoine culturel populaire : l’agriculture, l’élevage, les métiers, la médecine et la pharmacopée, la musique et la danse, la tradition orale, l’architecture populaire… Et il a attaqué violemment les langues autres que le castillan, pour toujours plus uniformiser la société et la dominer.
Félix Rodrigo Mora n’en parle pas mais le processus de « modernisation » a été à peu de choses près le même en France. Comme en Espagne il a été préparé par l’idéologie libérale. Puis, au nord des Pyrénées, ce n’est pas le franquisme qui a pris le relais mais la République progressiste et, à la Libération, les gouvernements de centre-gauche et de gauche. Pour Félix Rodrigo Mora, la gauche et la droite partagent la même conception d’un État fort et du développement industriel et technologique, censés apporter les biens matériels mais en réalité responsables de l’asservissement des citoyens et de la destruction de l’environnement.
Forêt, régime des pluies et fertilité des sols
Deux cents ans de politique libérale en agriculture, estime Félix Rodrigo Mora, ont abouti à un recul de la santé de la biosphère qui se traduit par une baisse des rendements agricoles, une diminution de la matière organique, l’augmentation de l’érosion et de la salinisation des sols, l’acidification et la pollution par les métaux lourds, la disparition des aires boisées, la désertification, la perte de biodiversité. Ajoutons à cela l’altération climatique liée à l’émission de gaz à effet de serre par la civilisation urbaine et industrielle.

La vigne (Campos de Carinena, Aragon) en culture intensive, comme les céréales ou l’olivier, stérilise les sols. Photo Diego Delso, Lic CC By SA 4 0, Wiki Commons.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics prônent l’agriculture biologique mais, pour l’auteur, celle-ci n’est que le nouveau cheval de bataille de l’agriculture industrielle et productiviste, en particulier avec le Règlement européen de 1991.
F. Rodrigo Mora insiste sur la gravité de la dégradation de l’espace naturel boisé, due à la fois à l’expansion des terres cultivées, aux effets de la civilisation industrielle et urbaine sur le climat et à la modification locale des équilibres : remplacement des espèces d’arbres autochtones par des espèces à croissance rapide (surtout les résineux, qui acidifient et stérilisent les sols) et uniformisation de la forêt, épuisement des sources et des nappes phréatiques par la diminution de la pluviosité et par le recours excessif à l’irrigation agricole, baisse de l’humidité de l’air liée au recul de la couverture du sol.
Dans un effet boule de neige, climat et recul de la forêt sont les causes de la perturbation du régime des pluies : la sécheresse estivale est de plus en plus longue dans la péninsule ibérique (100 à 130 jours aujourd’hui dans la Sierra Morena contre 74 au XVIIIe s.), ce qui fragilise les plantules et les jeunes brins et compromet leur croissance. Grâce à des précipitations estivales supérieures, il y avait d’importantes hêtraies au XVIIIe s. dans les Monts de Tolède et au XVIe dans la Mancha. La superficie boisée n’est plus, à l’heure actuelle, que de 15 % en Espagne, en comptant bien sûr les plantations industrielles.
Les parcelles céréalières qui recouvrent aujourd’hui d’énormes surfaces en Vieille et Nouvelle Castille, nues en été, ne remplissent plus la fonction d’infiltration des eaux de pluie et d’évaporation qui était celle des espaces boisés ; elles sont au contraire soumises au ruissellement et à l’érosion éolienne et l’on assiste à une forte dégradation des sols, irréversible pour des siècles. Cette dégradation est encore pire, on le sait, sur les pentes, comme le montrent les nombreux paysages désertiques du territoire espagnol.
Revenir à une existence frugale et conviviale
Pour Félix Rodrigo Mora, il est urgent de renverser la vapeur, de « détruire la société technique » et donc « d’adopter des systèmes techniques simples et une existence frugale et sobre », cela en « privilégiant les exigences immatérielles de l’être humain. » Il faut en même temps renoncer au mode de vie urbain (« qui inclut pouvoir centralisé, État, pouvoir des élites culturelles, argent, individualisme et consommation effrénée ») et revenir au style de vie rural.

La ville (Madrid, Avenida de América), un milieu extrêmement artificialisé, qui consomme les ressources naturelles. Photo Luis Garcia, Wiki Commons.
Il faut aussi « restaurer la nature », avec un nouveau type d’agriculture et une vision plus globale. Cela implique, comme avant l’industrialisation de l’agriculture, une gestion équilibrée de l’agriculture et de l’élevage (celui-ci apportant lait, viande, cuir, laine mais aussi et surtout matière organique) et de compter sur les importantes ressources alimentaires du milieu naturel : plantes et baies sauvages (plus de 150 ont été utilisées pour l’alimentation), champignons, chasse, pêche… La forêt, autrefois, fournissait par exemple des châtaignes et des glands (le pain de glands était la première ressource alimentaire de certaines régions) ou encore des branchages servant de fourrage pour les bêtes en été.
Et pour les terres cultivées, qui devraient être fortement réduites et se limiter aux terrains plats pour éviter l’érosion, il faudrait avoir des pratiques agronomiques appropriées : fertilisation naturelle par la végétation (feuilles des arbres) et les déjections des animaux, polyculture, association d’espèces, rotation, couverture permanente des sols par la végétation, très peu de labour, peu d’irrigation et de chimie, mécanisation minimale. Faire passer le régime alimentaire des 3 300 calories moyennes par jour actuelles à un niveau plus souhaitable de 2 500 permettrait de réduire d’un quart les terres cultivées. Pour le reste, il faudrait renoncer aux cultures d’exportation et aux « produits de plaisir » (café, thé, vin, tabac, sucre…). Ce qui en même temps permettrait aux pays producteurs de café, par exemple, de se réorienter vers les cultures vivrières pour leur consommation.
Cette ré-orientation demanderait à ce que chaque citoyen valide participe aux travaux liés à la ressource alimentaire. « Mais pour un temps limité, de manière à pouvoir avoir d’autres occupations. »
L’auteur estime aussi qu’il faudrait entreprendre une reforestation générale, qui consisterait à planter 20 millions d’hectares (en plus des 14 millions boisés actuellement) dans un délai de cinquante ans. Ce qui implique de « désagricoliser, désurbaniser et détouristifier ».
Tout cela n’est possible qu’avec « une révolution politique », car tout est politique, dit Félix Rodrigo Mora. Il cite l’exemple de l’automobile : « le régime actuel de dictature », dit-il (pour lui, la démocratie est directe ou elle n’est pas), « accorde aux populations soumises, dégradées, dépossédées une trompeuse illusion de liberté, de vitalité et de possession, aux fonctions narcotiques, alors que leur existence est dépossédée de tout sens et objectifs humains. »
L’auteur appelle donc à une révolution des mentalités et du mode de vie mais aussi à une révolution des modes de décision avec un retour à des conseils locaux ouverts et à la propriété communale (associée à la propriété privée limitée aux surfaces ne nécessitant pas de travail salarié).
Les propositions de Félix Rodrigo Mora peuvent paraître utopiques, mais si l’on considère que son analyse est réaliste, il faut apporter des réponses à la hauteur de l’enjeu. Le but, souligne-t-il, n’est pas de revenir à la société d’autrefois mais de se servir de ses points positifs pour construire une nouvelle société plus humaine et plus respectueuse de son environnement que l’actuelle.
Ph.C.
* * * * *
Voir les blogs de Félix Rodrigo Mora :
Et FélixRodrigoMora , avec ses publications.
Félix Rodrigo Mora donne, dans une vidéo (en castillan), une vision du Moyen Âge peu conforme au discours conventionnel des historiens. Voir la vidéo.
Sur les conseils ouverts et la propriété collective de l’espace rural voir aussi le livre de David Algarra Bascón, « El Comú Català. La història dels que no surten a la història » (« Le Commun Catalan. L’histoire de ceux que l’histoire ne fait pas apparaître »), Éditions Potlatch, 2015, en catalan.
Note de lecture dans ce blog sur ce livre.
Sur un thème proche, lire dans Éclairages Publics : « Révolution intégrale: plutôt que d’essayer de réformer la société, ils veulent en construire une autre. »
« El Comú Català » : la longue lutte du peuple contre la spoliation des biens communs
Publié : 21 décembre 2015 Classé dans : Bien public, Vie citoyenne | Tags: Bail emphytéotique, Bien commun, Catalogne, Communauté, Communs, Conseil ouvert, David Algarra Bascon, Désamortissements, Moyen Age, Propriété, Servitudes 1 commentaireLe « sacré droit de propriété » et la démocratie par délégation, qui dominent aujourd’hui notre société, n’ont pas toujours été la règle. David Algarra Bascón, dans « El Comú Català. La història dels que no surten a la història », décrit ce qui a été la réalité, du Haut Moyen Âge au XIXe, en Catalogne comme ailleurs : la propriété et la gestion communales de la terre et des espaces naturels par les communautés rurales et l’auto-gouvernement en assemblée de ces communautés et des communautés des villes.
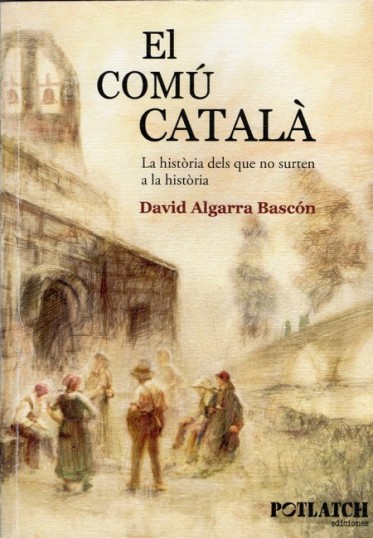
« El Comú Català. La història dels que no surten a la història » (« Le Commun Catalan. L‘histoire de ceux que l’Histoire ne fait pas apparaître ») est paru en octobre 2015 aux Ed. Potlatch.
Ce livre, en catalan, de David Algarra Bascón, dévoile une réalité cachée par l’histoire officielle (« Qui contrôle le passé, contrôle le futur », dit George Orwell). Cette histoire, c’est celle du « commun » catalan. Le commun, pour la communauté des habitants (villageoise ou urbaine) mais aussi pour les biens communs.
L’auteur s’appuie sur un considérable travail de documentation, qui transparaît, avec de nombreux exemples de situations locales dans toute la Catalogne et à diverses époques (la Catalogne nord n’est pas oubliée).
Son principal enseignement, c’est l’existence durant une longue période, au moins depuis le Haut Moyen Âge puis jusqu’au XIXe (avec un délitement progressif sous les coups de boutoir de la monarchie puis du libéralisme), d’un mode de vie et de gouvernement du peuple aujourd’hui disparu.
Il y avait d’une part une combinaison de la propriété familiale (sur les maisons, leurs dépendances et sur les terres cultivées) et de la propriété communale (sur les pâturages, les landes, les garrigues et les bois mais aussi sur des biens publics tels que moulins, forges, fours, boucheries, taverne, systèmes d’irrigation…). La notion de propriété n’avait pas le caractère absolu que nous connaissons aujourd’hui : c’était avant tout un droit d’usage, avec obligation de maintenir le bien de façon durable pour les générations à venir.
D’autre part, sur le droit d’usage familial se superposait un autre droit d’usage sous la forme d’une série de servitudes au profit de la communauté. Tout habitant du lieu pouvait faire paître ses animaux sur les terres de cultures d’autrui après la récolte (droit de « rostoll » ou vaine pâture, et de « redall » ou secondes herbes), ou ramasser les épis oubliés (« espigatge »). Le passage du bétail profitait en même temps à la parcelle, qui recevait le fumier.
L’ensemble des habitants bénéficiaient par ailleurs de droits d’usage sur les terrains communaux : pâturer, faire du bois de chauffage, couper du bois de charpente, chasser, pêcher, cueillir fruits et plantes sauvages…
Le tout était régulé de façon collective pour éviter les abus et assurer l’accès équilibré de chacun aux ressources communes. La communauté se réunissait en effet régulièrement en « conseil ouvert », auquel tous les habitants (toutes les familles) pouvaient participer. Ces conseils avaient non seulement une fonction économique mais aussi, et peut-être avant tout, une fonction d’assurer le vivre ensemble (le mot « convivencia », cher aux amoureux du passé occitan, est le même en catalan).
Ce mode de vie « en commun » comportait la solidarité et l’aide mutuelle. La femme y avait une liberté qu’elle perdra quelques siècles plus tard. Et la communauté disposait d’une grande autonomie face au pouvoir royal ou seigneurial, qu’elle défendait d’ailleurs au besoin avec sa milice populaire.
Un droit coutumier détruit par la force
Cette réalité se retrouve, avec des variantes, en Castille et Léon, au Pays Basque, dans les Asturies, en Galice, et aussi au-delà des Pyrénées dans les domaines francs (ou encore en Allemagne, en Angleterre…). (1)
David Algarra Bascón analyse comment, à travers les siècles, la notion de communs est apparue puis a été battue en brèche. Des vestiges archéologiques montrent que les Ibères, qui peuplaient la Catalogne avant l’arrivée des Romains, ainsi que les Aquitains et les Vascons (dans une frange pyrénéenne au nord), avaient une structure sociale égalitaire et disposaient de zones d’usage commun (fours, silos).

Photo elcomu.cat
La période romaine est une vraie coupure, avec l’imposition d’un système centralisé, oligarchique (grands domaines), patriarcal, esclavagiste. Mais avec la crise de l’empire on observe un retour à la campagne, une structuration en petits groupes avec des formes d’organisation de type communautaire et d’autosuffisance. L’unité d’exploitation, qui était la villa, devient la famille paysanne.
On note alors l’influence de la religion chrétienne, opposée (chez les premiers chrétiens) au patriarcat, à la propriété privée, à l’esclavage. Il faut noter que les premières églises rurales (VIe siècle) prennent la forme architecturale de la basilique, qui est un immeuble civil ; on peut penser qu’au-delà de leur fonction de lieu de culte elles avaient un usage de lieu de réunion.
Viennent les Wisigoths, puis les Francs. Ceux-ci amènent des populations, qui s’emparent de terres, mais les populations autochtones résistent. Au IXe, le déclin des Carolingiens s’accompagne d’une montée du pouvoir des populations dans le contrôle des terres.
Celui-ci, toutefois, était régi par un droit coutumier, non écrit. Le droit écrit appartiendra, par la suite, au Roi et aux seigneurs. Ceux-ci, avec les « chartes de peuplement » attribueront des « privilèges » : ils ne feront en fait que reconnaître les droits des occupants de la terre, c’est-à-dire les habitants et leurs communautés. Mais ce sera un premier pas dans la volonté d’accaparer ces terres.
Durant le Haut Moyen Âge et une partie du Bas Moyen Âge, le pouvoir n’était pas concentré, comme on l’imagine parfois, mais très divisé entre le Roi, le comte, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques et le pouvoir populaire. Les premiers s’efforcent d’imposer peu à peu leur domination et de percevoir des rentes au détriment des populations. La création des paroisses, à la fin du IXe siècle, sera l’occasion de mettre en place la dîme et les prémices.
La spoliation des terres communales va se faire au long des siècles sous la pression de divers éléments : l’endettement des communautés, pressurées par le Roi pour payer les frais occasionnés par les nombreuses guerres, les amènera à vendre des biens ; à partir des XVe-XVIe s., les seigneurs attribueront à certains paysans des terres selon un bail emphytéotique (de longue durée et moyennant une rente) ; ces « propriétaires » emphytéotiques auront ensuite tendance à refuser l’application des servitudes communales sur « leurs » terres et auront tendance à vouloir s’agrandir au détriment du communal.

La monarchie elle-même recourra, de 1798 à 1855, à des « désamortissements » (desamortitzacions) successifs, dont le dernier, le « désarmortissement de Madoz », aboutira à la vente des biens communaux : pour éponger ses dettes, le royaume avait décidé la vente des biens de l’Église, puis de ceux de l’État et des communs (terres, bâtiments, moulins et autres biens). En raison de l’instabilité politique (guerre napoléonienne, guerres civiles, guerres carlistes), l’application de ces décrets prendra du temps, mais l’abrogation des lois de désamortissement, en 1924, arrivera trop tard : le mal était fait.
Le prétexte budgétaire des désamortissements coïncide avec la montée du libéralisme, qui défend la propriété individuelle et exclusive.
Ce qui restait des biens communaux sera géré par l’État, notamment les bois, que les ingénieurs forestiers s’emploieront à artificialiser pour une utilisation marchande. D’ailleurs, au XXe s., l’expansion de l’agriculture productiviste, avec importation d’engrais et de carburants, coupera le lien avec la gestion traditionnelle des biens communaux, leur diversité d’utilisations et leur esprit durable.
Une longue résistance
Pour ce qui est des conseils ouverts, ils sont peu à peu remplacés, à partir du XIIe siècle et surtout au XIVe, et à l’initiative du pouvoir central, par des conseils fermés. Ils sont d’abord composés de représentants de la communauté, qui restent très liés par les décisions de celle-ci et n’ont qu’un pouvoir d’exécutif et de porte-parole, mais s’en affranchiront peu à peu. Puis, en 1716, les décrets de « nova planta » remplacent les conseils populaires par des municipalités (« ajuntaments ») le plus souvent dirigées par des magistrats (alcalde et conseil de regidors) nommés par le représentant du Roi. Les communautés continuent à lutter pied à pied pour conserver leurs conseils ouverts. Malgré cela, ceux-ci seront de plus en plus aux mains des élites locales dont la gestion sera peu conforme aux intérêts du peuple : perception croissante d’impôts, vente des biens communaux, souvent au bénéfice des gros propriétaires locaux.
Les élites espagnoles (l’Église, l’aristocratie et la bourgeoisie) auront donc réussi, bien qu’au bout de nombreux siècles du fait de la forte résistance populaire, à s’approprier les biens communs. Le régime libéral, en place à partir du XIXe, a une vision précise de la propriété : c’est la propriété des riches. Elle entraîne la prolétarisation des paysans, qui, privés de leurs moyens de subsistance, n’ont d’autre solution que d’aller vendre leur force de travail dans les villes.
L’expérience anarcho-syndicaliste, pendant la révolution sociale de 1936-39, s’est efforcée de recréer un pouvoir populaire dans les campagnes ; mais, dit David Algarra Bascón, « avec leur vision trop urbaine, ils n’ont pas compris qu’il y avait, de la part des paysans, une demande d’une solution mixte entre la propriété familiale et le travail collectif« . Il conclut avec l’historienne Rosa Congost : la fin de la société populaire rurale traditionnelle « n’est pas le triomphe de l’individualisme sur le collectivisme mais celui d’une minorité sur une majorité« . Ce que Blai Dalmau Solé dit d’une autre façon en parlant de « révolution des riches contre les pauvres ».
Ph.C.
1) Dans « L’Entraide, un facteur de l’évolution« , pages 289 à 292 (Ed. Ecosociété 2001), Pierre Kropotkine décrit le même processus de dépossession des communautés rurales tel qu’il s’est déroulé en France.
* * * * *
En savoir plus :
Le livre est en vente, à Perpignan, à la Llibreria Catalana, 7 Place Jean Payra, tél. 04 68 34 33 74, site de la Llibreria Catalana.
Sur le livre encore :
Coopérative Intégrale Catalane
Félix Rodrigo Mora (qui a préfacé ce livre) donne, dans une vidéo (en castillan), une vision du Moyen Âge peu conforme au discours conventionnel des historiens : Voir la vidéo
Publications de Félix Rodrigo Mora : Le livre « Naturaleza, ruralidad y civilización » (2008) évoque aussi le thème des communs.
Commentaires récents