L’Afrique au secours de l’Afrique
Publié : 5 janvier 2015 Classé dans : Mondialisation, Monnaie | Tags: Afrique, Décolonisation, Etats-Unis d'Afrique, franc cfa, Panafricanisme, Sanou Mbaye 1 commentairePour un changement intégral du système économique et monétaire
Sanou Mbaye. Éditions de l’Atelier, 2009 (édition de poche 2010)
L’Afrique a en elle les ressources pour se relever de son actuelle situation de précarité, explique en substance Sanou Mbaye. Il suffit que les puissants de ce monde laissent les pays africains mettre en œuvre leurs propres solutions. L’auteur propose une voie économique, en s’attachant plus particulièrement au système monétaire.
Sanou Mbaye estime que « trois handicaps sont au cœur du mal africain » : le déni par les détracteurs des Africains de « leur contribution à l’édification d’une civilisation de l’universel » (1) ; la « capacité d’auto-nuisance » qu’ont les Africains (mal gouvernance, corruption, division…) ; et les conséquences de longues périodes d’esclavage et de colonisation.
La pauvreté des pays africains, dit-il, a des causes structurelles : stratégies erronées de développement, dette, pratiques commerciales discriminatoires, persistance des institutions coloniales dont le franc CFA.
Suit une critique des institutions financières internationales (accord de prêts en échange d’une libéralisation de l’économie), de l’aide publique au développement et de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Le boulet du franc CFA
Aux indépendances, dit l’auteur, non seulement le franc CFA a été maintenu mais on a démantelé « le marché commun et les structures fédérales » existant sous le régime colonial. Dans ces conditions, le CFA est un lourd boulet. Il aurait fallu créer, dans les pays CFA, comme préalable d’une union monétaire, une union douanière et un marché commun.
Le franc handicape les pays de la zone CFA d’abord par sa convertibilité (restreinte à l’euro, avec un libre transfert de capitaux mais uniquement vers la France). Cette convertibilité n’est pas adaptée aux structures économiques actuelles des pays de la zone CFA : la non-convertibilité d’une monnaie, au contraire, peut permettre un contrôle des changes positif (qui donne à un gouvernement la possibilité d’allouer les devises – les entrées en monnaie étrangère – en priorité au développement des secteurs de l’économie qu’il juge prioritaires : par exemple, la production alimentaire, la santé…).
Par ailleurs, en échange de la convertibilité, la France impose aux États africains de déposer 50 % de leurs réserves de change au Trésor public français. Si ces dépôts (« comptes d’opérations ») sont créditeurs (c’est le cas le plus souvent), la France verse au pays africain concerné un intérêt (faible) ; s’ils sont débiteurs, la France prête ces sommes à taux élevé.
Ainsi, des sommes qui pourraient être investies dans le développement économique des pays CFA, selon leurs choix, dorment au Trésor français.
Autre problème du franc CFA, son taux de change fixe (par rapport à l’euro). Il est défavorable aux pays africains, qui exportent surtout des matières premières dont le prix est fixé en dollars (depuis sa création, l’euro s’est apprécié par rapport au dollar) et importent, majoritairement, des produits français en euros.
La constitution de deux zones CFA (2) est un autre handicap : les CFA de ces deux zones ne sont pas interchangeables, ce qui freine les relations commerciales entre elles.
Pour un changement intégral de système
Sanou Mbaye propose d’aller sur « la voie des réformes », c’est-à-dire vers un « changement intégral de système ».
Les pays africains, dit-il, doivent d’abord recouvrer la gestion de leurs réserves de change (passées et à venir).
Il faut supprimer la convertibilité du CFA.
Il propose ensuite la création d’une coopération monétaire entre les pays de la région, du type SME (système monétaire européen). Ce Système Monétaire Africain aurait pour objectifs la stabilité entre les monnaies des pays concernés et le rapprochement de leurs économies : réduction de l’instabilité des changes, réduction de l’inflation, union douanière, marché commun, union politique et monétaire.
Trois outils seraient à la base de cette coopération monétaire : une unité de compte de référence (comme l’Europe a eu son « écu », avant de créer l’euro) ; un mécanisme des taux de change et d’intervention (établissant la relation et l’équilibre entre les différentes monnaies) ; et un fonds de coopération monétaire (gestion des devises, des relations entre les banques et les instituts d’émission, de la stabilité des monnaies, fonds de cohésion pour la mise à niveau des économies les plus faibles).
Cette union politique et monétaire aurait pour point mire la constitution États-Unis d’Afrique.
L’Union Africaine
Sanou Mbaye évoque ensuite un plan d’action pour un développement de l’Afrique sur la base d’une Union Africaine.
Cela passe selon lui par la mobilisation des ressources (se réapproprier les matières premières), par le renouvellement de l’exercice du pouvoir selon des principes plus désintéressés.
Puis par une nouvelle stratégie de développement : marché commun, contrôle des ressources naturelles, contrôles des changes et des mouvements de capitaux, mesures protectionnistes (un thème très peu développé), usage à grande échelle du microcrédit, développement respectueux de l’environnement, contestation de la légalité des dettes.
Suit un chapitre sur la nécessité d’un « parapluie sécuritaire africain », dans l’esprit d’une « force panafricaine d’interposition travaillant de concert avec la communauté internationale ». Tout en souhaitant la fermeture des bases françaises et en s’opposant à l’arrivée des Américains. Manière pour l’Afrique de se soustraire à « des conflits occidentaux qui lui sont totalement étrangers ».
Le livre s’achève sur un plaidoyer pour un rééquilibrage mondial, où l’Afrique tiendrait sa place. Sur une critique de la mondialisation et du « Consensus de Washington » (qui prône la diminution du rôle des États, la libéralisation du commerce et du marché de capitaux, la dérégulation…). Et enfin sur un souhait de réforme du système monétaire international.
Sanou Mbaye, dans ce livre, décrit bien les effets du colonialisme monétaire que la France exerce à travers le franc CFA. Il le relie à la domination de la mondialisation néo-libérale. Il décrit ensuite un nouveau système économique et monétaire pour les pays africains, en passant très vite sur l’aspect économique.
Ce système paraît assez cohérent mais en même temps très idyllique. Sanou Mbaye se contente d’exposer des principes, somme toute assez théoriques, sans rentrer dans les écueils qui pourraient subvenir dans la construction de cette nouvelle donne (sans jeu de mot).
Par ailleurs, tout en critiquant les abus du libéralisme, il semble faire confiance aux mécanismes de l’économie de marché.
Ph.C.
1) L’auteur fait référence:
A Cheik Anta Diop, auteur de « Nations nègres et culture : de l’antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique noire aujourd’hui », Paris, Présence Africaine, 2000.
A Joseph Ki-Zerbo, historien auteur de « Histoire de l’Afrique Noire : d’hier à demain », Paris, Hatier, 1978.
Ainsi qu’à la Charte du Manden, proclamée en 1222 par Soundjata Keïta, empereur du Mali, et ses pairs.
2) Le franc CFA est en vigueur dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest, adhérents à l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et dont la banque centrale est la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) et 6 pays d’Afrique centrale adhérents à la Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale) et dont la banque centrale est le Beac (Banque centrale des États de l’Afrique Centrale).
Il y a en Afrique une troisième zone CFA, celle de l’Union des Comores.
Sanou Mbaye, ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement, est un chroniqueur politique et économique. Ses écrits sur le développement des pays africains proposent des politiques alternatives à celles mises en place, en Afrique, par des Occidentaux et leurs bras alliés : le FMI et la Banque mondiale. On peut visiter son blog.
Lire aussi, sur ce site, « Monnaie, servitude et liberté. La répression monétaire de l’Afrique », de Joseph Tchundjang-Pouemi.
L’Afrique à la reconquête de ses mines ?
Publié : 30 avril 2013 Classé dans : Mondialisation | Tags: Afrique, minerai, nationalisation Poster un commentaire«L’Afrique à la reconquête de ses mines» (d’après Le Monde des 28-29 avril 2013)
L’Afrique serait en train de remettre, en partie, la main sur ses richesses minières. C’est ce que décrit Le Monde des 28-29 avril (cahier géo&politique, pages 4-5), dans un mini-dossier intitulé «L’Afrique à la reconquête de ses mines» (signé Sébastien Hervieu et Charlotte Bozonnet).
Photo Hansueli Krapf (Wikipedia), mine de diamant Williamson à Mwadui (Tanzanie).
.
Sébastien Hervieu explique comment un discours favorable à la nationalisation des mines monte en Afrique du Sud, au sein-même de l’ANC, le parti au pouvoir, même si ce discours y reste minoritaire. Discours démagogique ? Peut-être, d’autant que l’ANC toucherait, à l’occasion des campagnes électorales, des financements des compagnies minières.
Et, en cas de nationalisation, l’État sud-africain devrait verser 84 milliards d’euros aux entreprises concernées, près d’un tiers du PIB du pays.
Une loi prévoit, en vertu d’une discrimination positive, que 26 % des capitaux des compagnies minières soient transférés à des noirs d’ici 2014. «L’objectif sera difficilement atteint», dit Le Monde.
Le gouvernement envisage par ailleurs de renforcer la compagnie minière nationale, l’AEMFC, mais pourra-t-il dégager les capitaux nécessaires ? Elle pourrait s’associer aux fonds souverains chinois ou russes.
Le congrès de l’ANC a adopté le principe d’une augmentation des taxes minières. Et les droits de douane sur les exportations de minerais non transformés pourraient eux aussi être augmentés.
Autant de signes d’une lente reconquête. Le bras de fer avec les sociétés minières reste loin d’être gagné : l’enjeu est de conserver au pays une partie croissante des richesses minières sans décourager les investisseurs étrangers…
Le Monde cite d’autres exemples de démarches des États africains pour se réapproprier les richesses de leur sous-sol. Ils sont aidés en cela par l’augmentation des cours mondiaux des minerais, liée à la demande des pays émergents.
La Tanzanie et la Zambie envisageraient, comme l’Afrique du Sud, d’augmenter la fiscalité. Le Niger (où se situent les mines d’uranium exploitées par Areva), le Sénégal et le Mozambique souhaiteraient renégocier les contrats. La Guinée a adopté un nouveau code minier ; le Ghana suivrait la même voie. Le Botswana a créé (en 1969 déjà) une société mixte avec la compagnie sud-africaine De Beers.
Cette tendance actuelle commence à contrebalancer la libéralisation du secteur, exigée par la Banque Mondiale dans les années 80 et 90. Il reste toutefois encore du chemin à faire pour que les pays parmi les plus riches de la planète en ressources naturelles (comme le Niger et la RDCongo) ne soient plus en réalité les plus pauvres (derniers au classement de l’Indice de développement humain des Nations Unies).
Philippe Cazal (30/04/2013)
Lire sur ce sujet, dans ce blog, « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique », d’Alain Deneault.
L’Alimentation, un bien public, pas une marchandise
Publié : 21 avril 2013 Classé dans : Alimentation | Tags: Afrique, alimentation, bien public, mondialisation Poster un commentaireLa sous-alimentation, en Afrique ou ailleurs, n’est pas une fatalité
Ce texte vous est proposé par Survie Languedoc-Roussillon.
Un milliard d’humains sous-alimentés
Sur les 7 milliards d’êtres humains qui en 2013 peuplent notre planète, 1 milliard souffre de sous-alimentation.
Chaque année 6 millions d’enfants de moins de dix ans meurent de faim.
14 % de l’humanité souffre de la faim mais en Afrique sub-saharienne, c’est un tiers de la population qui est concernée par la sous-alimentation.
Pourtant, l’agriculture mondiale a actuellement les moyens de nourrir 12 milliards de personnes.
Pouvoir se nourrir est un droit
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 10 décembre 1948) affirme le droit à l’alimentation.
Et la Déclaration de Vienne (25 juin 1993) demande aux Etats de ne pas s’opposer à la réalisation des droits énoncés dans la DUDH, dont la santé et l’alimentation.
Des déclarations malheureusement fort peu suivies d’effet.
L’alimentation doit être gérée en tant que bien public
Lorsque l’homme vivait de cueillette et de chasse, il lui suffisait d’utiliser les ressources de la nature pour se nourrir. Celles-ci n’appartenaient pas à quelques uns mais à tous. Elles constituaient un bien public de l’humanité.
La naissance de l’agriculture a permis d’améliorer l’alimentation, de lui assurer une plus grande régularité et une plus grande diversité. Cette évolution ne change rien au fait que les ressources de la nature appartiennent à tous les hommes.
En se construisant, les sociétés ont organisé la production alimentaire et sa répartition. Cela de façon plus ou moins équitable.
Survie considère que l’alimentation, comme l’air, l’eau, le sol…, est un bien public de l’humanité. Un bien public parce qu’il doit appartenir à tous, à l’état de ressource naturelle, mais aussi à l’état de bien construit par l’activité humaine en société : quelle que soit l’organisation de la production agricole, de la transformation agro-alimentaire, de la distribution alimentaire, le résultat doit être que chaque être humain mange à sa faim.
L’alimentation des êtres humains doit être un bien public, partagé équitablement, et non une source d’enrichissement de certains au détriment des autres.
La colonisation reste d’actualité
La confiscation du bien public alimentation s’est souvent reproduite dans l’histoire des peuples. Par l’asservissement des paysans à l’aristocratie puis à la bourgeoisie.
La colonisation a développé, en Afrique notamment, des cultures de rente destinées à être exportées vers la métropole : café, cacao, sucre, banane, ananas…
Une partie importante de l’agriculture africaine reste orientée vers les cultures d’exportation, aux dépens de l’agriculture vivrière, dont les populations locales ont besoin pour se nourrir. De nombreux petits paysans pratiquent aussi ces cultures d’exportation ; mais la plus-value en est accaparée par les sociétés qui exportent, transforment et distribuent ces produits.
Les entraves à l’alimentation
Un certain nombre de raisons font que l’accès des peuples à l’alimentation est entravé : les petits paysans ont souvent difficilement accès à la terre parce que les grands domaines se l’approprient.
Ces grands domaines sont aux mains des descendants des colons (par exemple en Afrique du Sud), des élites au pouvoir (Zimbabwe), de sociétés minières, d’Etats étrangers et des sociétés multinationales un peu partout en Afrique.
L’eau est souvent confisquée au profit de grands projets privés (exemple au Mali) ou des sociétés minières.
Les petits paysans, par ailleurs, ont du mal à accéder à la formation, à l’appui technique, aux fruits de la recherche, parce que les Etats n’ont pas de politique publique de développement agricole et parce que la recherche est souvent aux mains de firmes privées.
Ils n’ont pas non plus accès au minimum de moyens techniques (à commencer par la traction animale) qui leur permettraient d’obtenir des rendements corrects.
Une économie mondialisée tournée vers le profit
L’ordre économique mondial décourage les petits producteurs de produire des cultures vivrières.
Les plans d’ajustement structurel, ordonnés à partir des années 1980 par les institutions financières internationales (Banque Mondiale, FMI), ont obligé les pays en voie de développement à privilégier le remboursement de la dette aux détriment des dépenses sociales (santé, éducation, agriculture, transport). Ils ont en même temps poussé les Etats à promouvoir l’économie privée, les décourageant d’avoir des politiques agricoles publiques.
Plus récemment, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), en impulsant la réduction des barrières douanières, a favorisé les exportations (agricoles notamment) des pays riches vers les pays pauvres. Le « prix mondial » a découragé les paysans africains et autres de vendre leur production sur les marchés : avec des coûts de production souvent dix fois plus élevés que ceux des pays riches, ils ne sauraient être compétitifs sur un marché ouvert.
Mais la règle du jeu est biaisée : les Etats-Unis comme l’Europe (à travers la Pac, Politique agricole commune) ont subventionné leur agriculture pour lui permettre d’exporter (ces subventions, bien que réduites, persistent en 2013).
La règle des pays riches, c’est « libéralisez votre économie pendant que nous protégeons la nôtre ».
Ils la mettent actuellement en pratique à travers les APE (Accords de Partenariat Economique) que l’UE impose aux pays d’Afrique.
La faim : pas un problème de production mais de partage
La faim n’est pas essentiellement un problème de sous-production, de sécheresse ou d’infertilité des terres agricoles. C’est avant tout un problème de partage des ressources naturelles et de loyauté des échanges commerciaux.
La logique de l’agro-industrie, qui consiste à produire toujours plus quitte à détruire l’environnement, ne vise pas à satisfaire les besoins alimentaires mais à procurer du profit aux grandes exploitations, aux fournisseurs de semences, d’engrais, de produits chimiques, de machines, au négoce et à l’industrie agro-alimentaire.
L’agro-industrie prétend « nourrir le monde ». Ceux qui souffrent de la faim (majoritairement des familles paysannes) n’ont pas les moyens d’acheter ces produits alimentaires.
En vendant ses produits (à prix cassés grâce aux subventions) aux populations urbaines des pays en développement, l’agro-industrie rend impossible le développement de la production paysanne locale.
Par ailleurs, une part croissante de la production agricole mondiale n’est pas destinée à nourrir des humains mais à produire des agrocarburants.
La France participe à ce système mondial. Elle a une voix dans toutes les instances internationales qui imposent ce système économique. De plus, la complicité entre responsables politiques français et africains et sociétés multinationales aggrave cette logique de mainmise sur la terre, de développement de l’agro-industrie capitaliste et d’iniquité des échanges commerciaux, aux dépens du revenu des petits paysans et de l’alimentation des populations.
Propositions pour que chaque habitant de la planète ait les moyens de se nourrir
La souveraineté alimentaire de tous passe par :
Des politiques publiques
Pour s’épanouir, l’agriculture a besoin de soutiens publics, de politiques publiques. C’est le système de développement agricole que nous avons en France, aux Etats-Unis, mais que les institutions financières internationales interdisent aux pays du tiers monde.
Des moyens de développement
Les moyens à mettre en oeuvre : recherche, formation, conseil technique, accès aux semences, fertilisants, outils, crédit, moyens de communication, structures de transformation, de stockage et de commercialisation…
Et souvent, pour commencer, une réforme agraire.
Un modèle agricole conforme aux besoins des paysans
« L’important, ce n’est pas une production de masse mais la production par les masses », disait Gandhi.
L’agriculture familiale, celle qui nourrit les populations, est le type d’agriculture le plus à la portée des paysans et celui qui respecte le plus les ressources biologiques, donc le plus viable à long terme.
Il s’appuie sur la mise en valeur des pratiques agronomiques et savoir-faire locaux.
Un contrôle citoyen des moyens de production
L’organisation des agriculteurs en associations, syndicats, coopératives est un facteur clef du développement agricole.
Elle favorise son orientation dans l’intérêt public et non vers les intérêts privés.
L’organisation des marchés au niveau national
Sans organisation du marché, la production est toujours à la merci de la spéculation et de la concurrence.
Il est nécessaire de réguler les importations et les exportations, de gérer l’offre et les stocks, d’avoir des outils de gestion de crise…
Et au niveau interrégional
Des marchés communs régionaux, avec les incitations et les protections nécessaires, favoriseraient les échanges et le développement.
La démocratie mondiale
Replacer Banque Mondiale, FMI et OMC sous le contrôle de l’Onu pour leur redonner un fonctionnement démocratique.
Mettre en place, au sein de l’OMC, un commerce international juste, en accordant « l’exception agricole » aux pays en développement pour leur permettre de protéger leur agriculture, de lui apporter les soutiens publics nécessaires et lui accorder l’accès aux marchés des pays riches.
Survie Languedoc-Roussillon
5, impasse des Iris, 34790 Grabels
survielr@wanadoo.fr
Tél. 04 67 03 05 48
survie.org
survielero.blogspot.fr
facebook.com/survie.languedocroussillon
Sur le thème de l’alimentation, lire la présentation de « La Faim, pourquoi ?« , de François de Ravignan.
Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique
Publié : 1 avril 2013 Classé dans : Mondialisation | Tags: Afrique, Canada, compagnies minières, Deneault, pillage 1 commentaireLe poids des compagnies minières dans la société canadienne. Leurs pratiques en Afrique. Comment, au nom de l’économie, elles peuvent tout se permettre.
« Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique », d’Alain Deneault (avec Delphine Abadie et William Sacher), Ed. Ecosociété, Montréal 2008.
Suite à une action judiciaire, l’éditeur a retiré l’ouvrage de ses ventes. Il est disponible en pdf sur www.congoforum.be.
Un Dossier Noir d’Alain Deneault et William Sacher sur l’activité minière et le rôle pivot du Canada comme paradis judiciaire est en projet, en partenariat avec l’association Survie. Il n’est jamais trop tard pour lire « Noir Canada », l’un des ouvrages majeurs d’Alain Deneault (avec le concours actif de William Sacher et Delphine Abadie).
Dans Noir Canada, Alain Deneault explique le rôle déterminant des bourses de Vancouver puis, aujourd’hui, de Toronto dans l’activité des sociétés minières, canadiennes ou autres. Dans les années 90, les pouvoirs publics ont attribué à cette bourse la fonction de financer la relance de l’industrie minière canadienne. Elle a pour rôle d’attirer les capitaux, en particulier les capitaux à risque. Et elle est suffisamment peu regardante sur les pratiques des sociétés minières pour que tout « se passe bien ».
Peu importe si les sociétés minières, en particulier les « juniors » (celles qui découvrent les gisements sans avoir forcément les moyens d’investir dans l’exploitation), s’adonnent à la spéculation, pour faire de gros profits sur la valeur de leurs actions, plutôt que de participer au développement économique des pays où elles prospectent. Le jeu est ensuite de se faire racheter par une « major », qui aura les moyens d’investir dans l’exploitation du site et de capter la plus grande partie des richesses issues du sous-sol de la région concernée.
Le gouvernement canadien participe à la promotion de ce système en accordant aux sociétés minières des mesures fiscales et réglementaires avantageuses, qui contribuent à créer le « climat d’affaires » nécessaire. Mais aussi il édicte une législation laxiste, qui plutôt que de mettre ces sociétés devant leurs responsabilités, au sujet notamment de leurs activités douteuses en Afrique, s’attache à leur garantir au contraire une protection juridique.
Ce climat d’affaires attire bien entendu également les investisseurs étrangers : 60 % des sociétés minières mondiales sont inscrites à la Bourse de Toronto.
Paradis judiciaire, le Canada est aussi en relation avec les paradis fiscaux. Il a par exemple mis en place un « corridor fiscal » avec la Barbade, qui permet aux sociétés installées dans ce paradis fiscal de rapatrier leurs bénéfices au Canada sans être imposées.
L’état d’esprit qui règne autour de la Bourse de Toronto n’est pas étranger au fait que le Canada est le seul pays au monde dont l’industrie minière est intégrée verticalement : une intégration qui comprend les entreprises minières, les sociétés de courtage, les fabricants d’équipement, l’université…
Un climat très favorable aux prédateurs
Le livre illustre largement le comportement des sociétés minières « canadiennes » et autres (la composition du capital de ces grandes sociétés relativise souvent leur identité nationale).
C’est l’Afrique, bien sûr, qui est le théâtre privilégié de leur activité. Parce que ce continent regorge de ressources minières mais aussi parce qu’il est particulièrement vulnérable à l’action des prédateurs.
53 % des entreprises minières d’exploration qui travaillent en Afrique sont canadiennes et 45 % des sociétés minières toutes vocations confondues.
« Noir Canada » donne des exemples de leur comportement :
En Tanzanie, où Sutton est accusée d’avoir exproprié sans indemnisation les « creuseurs artisanaux » mais aussi d’avoir détruit leurs habitations et d’avoir bouché leurs trous au bulldozer (1996). Certains témoins affirment que lors de cette action 52 creuseurs auraient été ensevelis dans leurs trous. Dans une action en justice entreprise par Barrick Gold (repreneur de Sutton), l’auteur et l’éditeur n’ont pu apporter de preuves concernant ces affirmations. Ce qui les a amenés à retirer « Noir Canada » de la vente.
Photo issue du site Photo Libre
Au Mali (Sadiola) où Iam Gold et Anglo Gold exploitent l’or avec des coûts qui sont parmi les plus bas du monde (2003…). Et pour cause : elles ne prennent nullement en compte le milieu humain et naturel : les habitants soufrent de maladies respiratoires graves dues aux poussières (et aussi de leur teneur en arsenic), les femmes sont très nombreuse à subir des fausses-couches et le décès d’enfants en bas âge est très élevé, à cause du cyanure qui pollue l’eau potable…
Au Ghana, ce sont les manifestants, qui protestent contre un millier de licenciements, qui se voient tirer dessus par la police (neuf mineurs tués en 1999).
La partie sur le Congo Kinshasa est particulièrement développée. Ce pays est très riche en minerais de toutes sortes. Et les sociétés minières sont fortement impliquées dans son histoire politique de ces dernières décennies.
Mobutu pillait tout seul les richesses de son pays. Les sociétés minières se sont occupées de financer et d’armer Laurent Désiré Kabila pour le chasser… et prendre leur part du pactole. En échange de leur appui, elles se font accorder des contrats d’exploitation « léonins », où elles se voient attribuer des concessions pour une bouchée de pain et avec très peu d’imposition. Au détriment bien sûr des sociétés minières nationales, en particulier la Gecamines, et sans aucune contribution au développement économique du Congo.
Lorsque Kabila, arrivé au pouvoir (1998), voudra s’affranchir de leur tutelle et unifier le pays, les minières se retournent contre lui et s’allient à l’Ouganda et au Rwanda. Chacun de ces pays crée, en enrôlant des Congolais, un mouvement de lutte armée, l’Ouganda le RCD, le Rwanda le MLC (de Jean-Pierre Bemba). C’est à qui contrôlera le maximum de territoires miniers, en mettant le pays à feu et à sang. Les sociétés minières sont toujours gagnantes : elles arment les uns et les autres et garantissent ainsi, quoi qu’il arrive, leurs droits d’exploitation.
Le trafic d’armes, qui est un moyen de régner, peut devenir l’activité principale. Comme en Sierra Leone où « on exploite le diamant pour vendre des armes plutôt que l’inverse ». L’activité minière est alors une couverture.
Les exactions liées aux compagnies minières en Afrique ne peuvent se résumer aux débordements de quelques sociétés. Les sociétés minières bénéficient, pour le moins, d’un climat favorable : lorsque par exemple le FMI incite les gouvernements à privatiser les mines, en échange de prêts ou « d’aides au développement » ; ou lorsque la Banque Mondiale participe au capital d’une société qui exploite le sous-sol au mépris des populations (Sadiola, au Mali).
« L’ami de l’Afrique »
Le troisième grand thème du livre est l’étude de la façon dont les pouvoirs publics canadiens eux-mêmes favorisent et couvrent ces activités de leurs sociétés à l’étranger.
L’un des aspects de la doctrine des pouvoirs publics est le suivant : « Un des principaux rôles du gouvernement est de fournir l’assise capable de légitimer les relations de marché aux yeux des citoyens ».
Alain Deneault étudie le discours de ces pouvoirs publics sur la surveillance des sociétés minières et montre que dans les faits ils s’emploient à les protéger de toute remise en cause.
Il s’inspire par exemple de la loi étatsunienne (2002) sur le contrôle des investissements financiers (qui fait suite à la faillite d’Enron)… tout en l’édulcorant. Les contrôles sont en fait peu appliqués. De même, on est peu exigeants vis-à-vis des sociétés cotées sur la réalité de la valeur économique qu’elles déclarent.
Le Canada « Ami de l’Afrique » l’est surtout en paroles. Il ne fait rien pour chercher la responsabilité de ses sociétés accusées de crimes dans plusieurs pays d’Afrique.
Photo issue du site Photo Libre
Le Canada n’est par ailleurs pas avare de discours en faveur de la paix tout en étant le 6e pays exportateur d’armement.
Un chapitre sur la francophonie montre que le Québec n’a pas su mettre en œuvre une politique plus exemplaire que celle de l’instance fédérale. La francophonie lui a permis d’accéder aux tribunes internationales, à condition de ne pas remettre en cause la ligne de la France, et donc de signer, à côté des dictateurs africains, des déclarations lénifiantes sur les droits de l’Homme et la démocratie.
L’un des rôles de la francophonie, explique Alain Deneault, c’est de mettre en avant une doctrine économique, celle qui lui est dictée notamment par Michel Camdessus, membre de son « haut conseil » et ex-directeur du FMI, « l’acteur des plans d’ajustement structurel ».
« Comment amener la société civile canadienne à se remettre en cause par rapport à son attitude coloniale ? », se demande l’auteur en conclusion. Les fonds de retraite et les placements publics peuvent-ils continuer longtemps à prospérer sur l’exploitation des richesses de l’Afrique ? D’ailleurs, les Canadiens doivent prendre conscience que « le continent noir est le laboratoire des modalités d’exploitation que l’on s’apprête à imposer chez nous ».
Quant à la France, ce livre y fait souvent indirectement allusion. L’auteur relie à plusieurs reprises ses observations sur les positions des pouvoirs publics ou des sociétés minières canadiennes aux travaux de François-Xavier Verschave sur la Françafrique. Le « noir Canada » et la « Françafrique », deux mondes qui participent d’une même logique.
Philippe Cazal (18/04/2013)
«L’Afrique à la reconquête de ses mines»
L’Afrique serait en train de remettre, en partie, la main sur ses richesses minières. C’est ce que décrit Le Monde des 28-29 avril (cahier géo&politique, pages 4-5), dans un mini-dossier intitulée «L’Afrique à la reconquête de ses mines» (signé Sébastien Hervieu et Charlotte Bozonnet).
Sébastien Hervieu explique comment un discours favorable à la nationalisation des mines monte en Afrique du Sud, au sein-même de l’ANC, le parti au pouvoir, même si ce discours y reste minoritaire. Discours démagogique ? Peut-être, d’autant que l’ANC toucherait, à l’occasion des campagnes électorales, des financements des compagnies minières.
Et, en cas de nationalisation, l’État sud-africain devrait verser 84 milliards d’euros aux entreprises concernées, près d’un tiers du PIB du pays.
Une loi prévoit, en vertu d’une discrimination positive, que 26 % des capitaux des compagnies minières soient transférés à des noirs d’ici 2014. «L’objectif sera difficilement atteint», dit Le Monde.
Le gouvernement envisage par ailleurs de renforcer la compagnie minière nationale, l’AEMFC, mais pourra-t-il dégager les capitaux nécessaires ? Elle pourrait s’associer aux fonds souverains chinois ou russes.
Le congrès de l’ANC a adopté le principe d’une augmentation des taxes minières. Et les droits de douane sur les exportations de minerais non transformés pourraient eux aussi être augmentés.
Autant de signes d’une lente reconquête. Le bras de fer avec les sociétés minières reste loin d’être gagné : l’enjeu est de conserver au pays une partie croissante des richesses minières sans décourager les investisseurs étrangers…
Le Monde cite d’autres exemples de démarches des États africains pour se réapproprier les richesses de leur sous-sol. Ils sont aidés en cela par l’augmentation des cours mondiaux des minerais, liée à la demande des pays émergents.
La Tanzanie et la Zambie envisageraient, comme l’Afrique du Sud, d’augmenter la fiscalité. Le Niger (où se situent les mines d’uranium exploitées par Areva), le Sénégal et le Mozambique souhaiteraient renégocier les contrats. La Guinée a adopté un nouveau code minier ; le Ghana suivrait la même voie. Le Botswana a créé (en 1969 déjà) une société mixte avec la compagnie sud-africaine De Beers.
Cette tendance actuelle commence à contrebalancer la libéralisation du secteur, exigée par la Banque Mondiale dans les années 80 et 90. Il reste toutefois encore du chemin à faire pour que les pays parmi les plus riches de la planète en ressources naturelles (comme le Niger et la RDCongo) ne soient plus en réalité les plus pauvres (derniers au classement de l’Indice de développement humain des Nations Unies).
Philippe Cazal (30/04/2013)
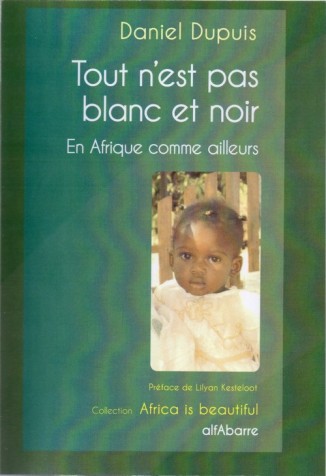
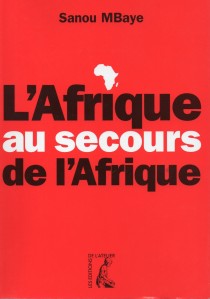






Commentaires récents