Le fruit du chêne, un aliment pour l’homme
Publié : 28 février 2023 Classé dans : Alimentation, Bien public, Biodiversité | Tags: Agro-foresterie, alimentation, Chêne, Commun, Dehesa, Gland Poster un commentaireCadeau de la nature qu’il suffit de ramasser, le gland a de tous temps participé à l’alimentation humaine dans les régions du pourtour méditerranéen, en particulier en période de disette. En Espagne et au Portugal, il trouve un regain d’intérêt dans un esprit de redécouverte d’une production traditionnelle et de mise en valeur d’une ressource naturelle.
On connaît le fameux jambon « ibérico de bellota », le jambon de cochons nourris aux glands en Extremadura (sud-ouest de l’Espagne). Il fait partie d’un système d’élevage qui a pour cadre la « dehesa », ce parcours planté de chênes clairsemés, exemple d’agro-foresterie traditionnelle que l’on retrouve aussi en Andalousie et au sud du Portugal (Alentejo).
Ce que l’on sait moins c’est que les glands ont été utilisés en alimentation humaine sur tout le pourtour méditerranéen et notamment en Espagne depuis le temps des chasseurs-cueilleurs, au Paléolithique, d’abord en fruit de cueillette puis en complément des cultures de céréales ; et cela jusque dans les années 1960. Ils ont joué un grand rôle dans les périodes de famine, sauvant bien des vies humaines. Un livre récemment paru rapporte de nombreux témoignages de l’utilisation des glands à travers l’histoire (1).

Cette pratique de consommation des glands faisait partie du système de vie rurale, où les bois et la forêt étaient un commun, appartenant à la communauté villageoise, riche en ressources (bois de chauffage et de construction, fourrage de feuilles d’arbres, baies, champignons, gibier, plantes médicinales, etc.) et jouant par conséquent un rôle déterminant dans l’économie locale, à côté des cultures.
Les boisements de chênes ont donc été soignés par les habitants, parfois en plantant des arbres, le plus souvent en sélectionnant ceux qui produisaient les meilleurs glands et en coupant les moins intéressants.
Les glands de toutes les espèces de chênes sont comestibles mais leur teneur en tanins varie, ce qui exige de désamériser ceux qui ont de fortes teneurs en tanins (et donc en toxines).
En élevage, les porcs mangent sans problème toutes les espèces de glands parce que, comme les sangliers et les cerfs, ils ont développé des défenses contre les tanins. Ce n’est pas le cas des équins, des bovins et des ovins, qui peuvent tomber gravement malades après l’ingestion de glands amers.
Les glands doux sont produits par un chêne vert, le Quercus ilex subsp. ballota ou le Quercus ilex subsp. rotundifolia, que les botanistes considèrent tantôt comme deux sous-espèces très proches, tantôt comme la même sous-espèce. On trouve ce chêne dans la majeure partie de la péninsule ibérique et au Maghreb. Ses feuilles sont plus arrondies et moins porteuses de piquants que celles de l’autre chêne vert, Quercus ilex ilex.
Celui-ci, aux glands amers, est très présent au nord de l’Espagne (côte atlantique et Catalogne), dans le sud de la France, en Italie et en Grèce.
Les autres espèces donnent des glands encore plus amers : Quercus suber (chêne liège), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus pubescens (chêne pubescent), Quercus coccifera (chêne kermès). Mais tous leurs glands sont utilisables.
On a noté qu’il existe des variations, pour la teneur en tanins, non seulement entre espèces mais aussi entre arbres de la même espèce et entre les différentes parties d’un même arbre. Les anciens en tenaient compte dans leur travail de sélection.
La récolte des glands a lieu selon les régions à partir de la fin septembre, surtout en octobre pour Quercus ilex ilex, parfois en février pour Quercus coccifera. La glandée est assez irrégulière selon les années.
Les glands doivent être cueillis à maturité, soit quand ils sont tombés au sol soit en secouant les branches avec de longues baguettes.
Ils peuvent être mangés frais ; ils le restent au maximum trois mois. Au-delà il y a plusieurs méthodes de conservation : le séchage, la torréfaction et aussi, dans l’Antiquité, l’immersion dans de l’eau.
Les méthodes de conservation servent aussi à désamériser les glands : on peut les lessiver, comme les olives, les faire sécher, les faire cuire dans de l’eau, ou encore les griller (dans la braise ou, par exemple, avec une poêle munie de trous ; il faut les fendre pour qu’ils n’éclatent pas).
Avant de les manger on les pèle pour enlever le péricarpe (écorce) et le tégument (peau) et ne manger que la chair (les cotylédons).
Le gland de chêne est riche en protéines et acides gras monoinsaturés. Il a été utilisé en médecine, encore au XXe siècle, contre la diarrhée, à cause de ses tanins.
En Espagne et au Portugal, on voit un mouvement de réhabilitation du gland dans l’alimentation et la gastronomie. Les usages culinaires sont nombreux : nature verts (pour les doux), séchés ou grillés ; en farine (pour le pain et la pâtisserie) ; en purée, en tourtes, omelettes, croquettes, crêpes ; et même pour faire de la bière et de la liqueur.
Ce retour du gland de chêne est en rapport avec le développement d’une économie rurale qui met à profit les traditions et en même temps avec une prise en compte de la diversité des ressources naturelles : il s’agit non seulement de cesser de détruire la nature mais aussi de la prendre comme elle est, avec ses richesses.
Ph.C.
1) « Las bellotas y el ser humano. Avatares de un símbolo en la península ibérica », Enrique García Gómez et Juan Pereira Sieso, Éditions Cuarto centenario, 2022.
L’Alimentation, un bien public, pas une marchandise
Publié : 21 avril 2013 Classé dans : Alimentation | Tags: Afrique, alimentation, bien public, mondialisation Poster un commentaireLa sous-alimentation, en Afrique ou ailleurs, n’est pas une fatalité
Ce texte vous est proposé par Survie Languedoc-Roussillon.
Un milliard d’humains sous-alimentés
Sur les 7 milliards d’êtres humains qui en 2013 peuplent notre planète, 1 milliard souffre de sous-alimentation.
Chaque année 6 millions d’enfants de moins de dix ans meurent de faim.
14 % de l’humanité souffre de la faim mais en Afrique sub-saharienne, c’est un tiers de la population qui est concernée par la sous-alimentation.
Pourtant, l’agriculture mondiale a actuellement les moyens de nourrir 12 milliards de personnes.
Pouvoir se nourrir est un droit
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 10 décembre 1948) affirme le droit à l’alimentation.
Et la Déclaration de Vienne (25 juin 1993) demande aux Etats de ne pas s’opposer à la réalisation des droits énoncés dans la DUDH, dont la santé et l’alimentation.
Des déclarations malheureusement fort peu suivies d’effet.
L’alimentation doit être gérée en tant que bien public
Lorsque l’homme vivait de cueillette et de chasse, il lui suffisait d’utiliser les ressources de la nature pour se nourrir. Celles-ci n’appartenaient pas à quelques uns mais à tous. Elles constituaient un bien public de l’humanité.
La naissance de l’agriculture a permis d’améliorer l’alimentation, de lui assurer une plus grande régularité et une plus grande diversité. Cette évolution ne change rien au fait que les ressources de la nature appartiennent à tous les hommes.
En se construisant, les sociétés ont organisé la production alimentaire et sa répartition. Cela de façon plus ou moins équitable.
Survie considère que l’alimentation, comme l’air, l’eau, le sol…, est un bien public de l’humanité. Un bien public parce qu’il doit appartenir à tous, à l’état de ressource naturelle, mais aussi à l’état de bien construit par l’activité humaine en société : quelle que soit l’organisation de la production agricole, de la transformation agro-alimentaire, de la distribution alimentaire, le résultat doit être que chaque être humain mange à sa faim.
L’alimentation des êtres humains doit être un bien public, partagé équitablement, et non une source d’enrichissement de certains au détriment des autres.
La colonisation reste d’actualité
La confiscation du bien public alimentation s’est souvent reproduite dans l’histoire des peuples. Par l’asservissement des paysans à l’aristocratie puis à la bourgeoisie.
La colonisation a développé, en Afrique notamment, des cultures de rente destinées à être exportées vers la métropole : café, cacao, sucre, banane, ananas…
Une partie importante de l’agriculture africaine reste orientée vers les cultures d’exportation, aux dépens de l’agriculture vivrière, dont les populations locales ont besoin pour se nourrir. De nombreux petits paysans pratiquent aussi ces cultures d’exportation ; mais la plus-value en est accaparée par les sociétés qui exportent, transforment et distribuent ces produits.
Les entraves à l’alimentation
Un certain nombre de raisons font que l’accès des peuples à l’alimentation est entravé : les petits paysans ont souvent difficilement accès à la terre parce que les grands domaines se l’approprient.
Ces grands domaines sont aux mains des descendants des colons (par exemple en Afrique du Sud), des élites au pouvoir (Zimbabwe), de sociétés minières, d’Etats étrangers et des sociétés multinationales un peu partout en Afrique.
L’eau est souvent confisquée au profit de grands projets privés (exemple au Mali) ou des sociétés minières.
Les petits paysans, par ailleurs, ont du mal à accéder à la formation, à l’appui technique, aux fruits de la recherche, parce que les Etats n’ont pas de politique publique de développement agricole et parce que la recherche est souvent aux mains de firmes privées.
Ils n’ont pas non plus accès au minimum de moyens techniques (à commencer par la traction animale) qui leur permettraient d’obtenir des rendements corrects.
Une économie mondialisée tournée vers le profit
L’ordre économique mondial décourage les petits producteurs de produire des cultures vivrières.
Les plans d’ajustement structurel, ordonnés à partir des années 1980 par les institutions financières internationales (Banque Mondiale, FMI), ont obligé les pays en voie de développement à privilégier le remboursement de la dette aux détriment des dépenses sociales (santé, éducation, agriculture, transport). Ils ont en même temps poussé les Etats à promouvoir l’économie privée, les décourageant d’avoir des politiques agricoles publiques.
Plus récemment, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), en impulsant la réduction des barrières douanières, a favorisé les exportations (agricoles notamment) des pays riches vers les pays pauvres. Le « prix mondial » a découragé les paysans africains et autres de vendre leur production sur les marchés : avec des coûts de production souvent dix fois plus élevés que ceux des pays riches, ils ne sauraient être compétitifs sur un marché ouvert.
Mais la règle du jeu est biaisée : les Etats-Unis comme l’Europe (à travers la Pac, Politique agricole commune) ont subventionné leur agriculture pour lui permettre d’exporter (ces subventions, bien que réduites, persistent en 2013).
La règle des pays riches, c’est « libéralisez votre économie pendant que nous protégeons la nôtre ».
Ils la mettent actuellement en pratique à travers les APE (Accords de Partenariat Economique) que l’UE impose aux pays d’Afrique.
La faim : pas un problème de production mais de partage
La faim n’est pas essentiellement un problème de sous-production, de sécheresse ou d’infertilité des terres agricoles. C’est avant tout un problème de partage des ressources naturelles et de loyauté des échanges commerciaux.
La logique de l’agro-industrie, qui consiste à produire toujours plus quitte à détruire l’environnement, ne vise pas à satisfaire les besoins alimentaires mais à procurer du profit aux grandes exploitations, aux fournisseurs de semences, d’engrais, de produits chimiques, de machines, au négoce et à l’industrie agro-alimentaire.
L’agro-industrie prétend « nourrir le monde ». Ceux qui souffrent de la faim (majoritairement des familles paysannes) n’ont pas les moyens d’acheter ces produits alimentaires.
En vendant ses produits (à prix cassés grâce aux subventions) aux populations urbaines des pays en développement, l’agro-industrie rend impossible le développement de la production paysanne locale.
Par ailleurs, une part croissante de la production agricole mondiale n’est pas destinée à nourrir des humains mais à produire des agrocarburants.
La France participe à ce système mondial. Elle a une voix dans toutes les instances internationales qui imposent ce système économique. De plus, la complicité entre responsables politiques français et africains et sociétés multinationales aggrave cette logique de mainmise sur la terre, de développement de l’agro-industrie capitaliste et d’iniquité des échanges commerciaux, aux dépens du revenu des petits paysans et de l’alimentation des populations.
Propositions pour que chaque habitant de la planète ait les moyens de se nourrir
La souveraineté alimentaire de tous passe par :
Des politiques publiques
Pour s’épanouir, l’agriculture a besoin de soutiens publics, de politiques publiques. C’est le système de développement agricole que nous avons en France, aux Etats-Unis, mais que les institutions financières internationales interdisent aux pays du tiers monde.
Des moyens de développement
Les moyens à mettre en oeuvre : recherche, formation, conseil technique, accès aux semences, fertilisants, outils, crédit, moyens de communication, structures de transformation, de stockage et de commercialisation…
Et souvent, pour commencer, une réforme agraire.
Un modèle agricole conforme aux besoins des paysans
« L’important, ce n’est pas une production de masse mais la production par les masses », disait Gandhi.
L’agriculture familiale, celle qui nourrit les populations, est le type d’agriculture le plus à la portée des paysans et celui qui respecte le plus les ressources biologiques, donc le plus viable à long terme.
Il s’appuie sur la mise en valeur des pratiques agronomiques et savoir-faire locaux.
Un contrôle citoyen des moyens de production
L’organisation des agriculteurs en associations, syndicats, coopératives est un facteur clef du développement agricole.
Elle favorise son orientation dans l’intérêt public et non vers les intérêts privés.
L’organisation des marchés au niveau national
Sans organisation du marché, la production est toujours à la merci de la spéculation et de la concurrence.
Il est nécessaire de réguler les importations et les exportations, de gérer l’offre et les stocks, d’avoir des outils de gestion de crise…
Et au niveau interrégional
Des marchés communs régionaux, avec les incitations et les protections nécessaires, favoriseraient les échanges et le développement.
La démocratie mondiale
Replacer Banque Mondiale, FMI et OMC sous le contrôle de l’Onu pour leur redonner un fonctionnement démocratique.
Mettre en place, au sein de l’OMC, un commerce international juste, en accordant « l’exception agricole » aux pays en développement pour leur permettre de protéger leur agriculture, de lui apporter les soutiens publics nécessaires et lui accorder l’accès aux marchés des pays riches.
Survie Languedoc-Roussillon
5, impasse des Iris, 34790 Grabels
survielr@wanadoo.fr
Tél. 04 67 03 05 48
survie.org
survielero.blogspot.fr
facebook.com/survie.languedocroussillon
Sur le thème de l’alimentation, lire la présentation de « La Faim, pourquoi ?« , de François de Ravignan.
La Bio entre business et projet de société
Publié : 25 mars 2013 Classé dans : Bio | Tags: alimentation, Bio Poster un commentaireEntre éthique et business ‹ L’agriculture bio est-elle en train d’échapper à ses précurseurs pour devenir un agro-business comme les autres ?
« La Bio entre business et projet de société ». Livre collectif, sous la direction de Philippe Baqué. Contre-feux, Agone, 2012.
La Bio à la croisée des chemins
Quelle différence y a-t-il entre une tomate bio et une tomate bio ? En termes de qualité alimentaire, peut-être pas beaucoup. Mais la différence peut être considérable entre deux tomates labellisées bio selon la façon dont elles ont été produites, différence en termes d’impact sur l’environnement et la biodiversité, de revenu du producteur, de développement local ou de conditions de travail des salariés.
En fait, qu’est-ce que l’agriculture biologique ? Peut-on se contenter de lui demander de fournir une alimentation saine ou est-ce une démarche plus globale, qui s’intéresse au contexte social et politique de cette agriculture ?
Le livre « La Bio entre business et projet de société », paru ce printemps aux éditions Agone sous la direction de Philippe Baqué, pose ces questions et s’efforce d’y répondre, à travers une série de reportages en France et dans le monde.
L’idée de réaliser ce livre est née parmi un groupe de journalistes indépendants, agriculteurs, agronome, économiste, sociologue, militants… qui se sont mis au travail ensemble.
L’ouvrage, très riche en exemples et en témoignages, s’appuie d’abord sur l’observation de la réalité et sur l’évolution de la bio à travers son histoire. Pour mieux amener la réflexion et s’interroger sur les choix de société qui sous-tendent deux façons de faire de l’agriculture biologique.
Car si les agriculteurs biologiques étaient, il y a peu, considérés comme des marginaux, la bio est devenue un créneau en fort développement. D’où un mouvement important de conversion d’agriculteurs du conventionnel à la bio. Mais aussi un fort courant d’importation : 35 % des produits bio consommés en France sont importés (et 60 % des fruits et légumes).
Ces aliments bio, français, européens ou venant de plus loin, sont produits le plus souvent avec des méthodes de culture et d’élevage industrielles, en monoculture, dans une logique de réduction des coûts et de compétition qui entraîne l’exploitation de la main-d’œuvre (ou du paysan en intégration, voire l’auto-exploitation du coopérateur) et le pillage des ressources naturelles.
Le goût amer de l’huile de palme
En Colombie, le groupe Daabon cultive (à côté d’immenses superficies en conventionnel) environ 4 500 ha de palmiers à huile et 1 000 ha de bananiers en agriculture biologique. Ces grandes exploitations de monoculture à hauts rendements produisent pour l’exportation et fournissent la distribution européenne (GD et magasins spécialisés) et l’industrie des cosmétiques. On sait que l’huile de palme, en raison de son bas prix notamment, rentre aujourd’hui dans la composition d’un grand nombre de produits alimentaires et cosmétiques, consommés en France notamment.
Daabon est aussi un important producteur d’agro-carburants.
Le groupe est accusé d’avoir entretenu des liens avec les paramilitaires colombiens. En Colombie, il est fréquent, à la faveur de l’instabilité causée par la lutte entre l’Etat et la guérilla, que les gros propriétaires fassent chasser les paysans de leurs terres pour prendre leur place.
Par ailleurs, avant les années 1990, la Colombie était autosuffisante sur le plan alimentaire. Depuis, la production agro-industrielle pour l’exportation a explosé et aujourd’hui la Colombie importe massivement des aliments de base.
Le label bio européen, note l’auteur de ce chapitre, bien qu’il « incite » à la biodiversité, autorise la monoculture de plantes pérennes ; il ne limite pas la taille des exploitations et ne comprend aucun critère social.
Acheter des produits bio de Daabon, n’est-ce pas cautionner l’expulsion des paysans, les crimes des paramilitaires, le triomphe des agro-carburants au détriment des cultures vivrières ? Or, souligne l’auteur, Daabon continue à bénéficier, en France, « du soutien inconditionnel du réseau Biocoop », le leader de la distribution spécialisée de produits bio.
Des poulets bio à croissance forcée
Dans le Sud-Ouest de la France, Maïsadour est l’un des leaders du poulet bio. La production est intégrée : la coopérative livre les poussins et les aliments, rachète les poulets et les commercialise. Le label européen permet la production dans des bâtiments jusqu’à 1 600 m2, avec des densités de 16 volailles au m2 pour les bâtiments mobiles et 10 pour les bâtiments fixes. Tous les poussins sont vaccinés, l’épointage du bec est possible, les antibiotiques sont autorisés (un par an pour les poulets de chair, trois pour les poules pondeuses), les antiparasitaires aussi et l’abattage peut intervenir à 81 jours.
L’aliment bio pour les volailles est à base de maïs (surtout d’Italie) et de soja (du Brésil, de Chine ? Un certain flou règne sur la provenance).
Au Brésil, le soja bio est produit sur des fermes de plusieurs milliers d’hectares, surtout dans le Mato Grosso, l’Etat du Brésil où la déforestation est la plus forte. Le label bio européen n’interdit pas de cultiver sur des terres issues de la déforestation.
A côté de l’élevage bio intensif, des petits producteurs, dans le Sud-Ouest, travaillent dans le souci de la biodiversité sur leur exploitation (volailles, autres élevages, céréales, oléagineux, arbo…), transforment souvent artisanalement, vendent en circuit court. L’aliment des animaux vient de la ferme ou de fermes voisines. La taille des élevages est limitée, les poulets sont abattus à 120 ou 130 jours, pour le goût et la qualité de la viande…
L’auteur du chapitre illustre l’impact du système de production sur le revenu de l’agriculteur avec deux exemples : celui, d’abord, d’un éleveur bio traditionnel de volailles, qui vend celles-ci à 7,50 €/kilo. Avec un coût de production de 2,80 € et un coût de mise en marché de 1,30 €, il dégage un revenu de 3,40 €/kilo. Et l’exemple d’un éleveur en système intégré : l’intégrateur vend les volailles 5,50 €/kilo ; le coût de production est de 2,70 €/kilo et la marge de l’intégrateur de 2,20 €/kilo, ce qui laisse 0,60 €/kilo au producteur. « D’où la tendance à devoir produire toujours plus ».
Fruits et légumes intensifs, salariés malmenés
En Andalousie, la mer de plastique des provinces d’Almeria et Huelva des années 1980 est toujours là. Mais une partie des producteurs se sont reconvertis à la bio, pour tenter de lutter contre la baisse des prix qui leur sont payés.
Des ouvrières agricoles dans les serres de fraises bio du Sud de l’Espagne.
Photo Philippe Baqué.
Il est difficile de trouver une différence entre les productions bio et conventionnelles. Les fraises du Parc de Doñana (province de Huelva) sont cultivées en hors-sol dans une culture hydroponique qui ne dit pas son nom. En bio comme en conventionnel, elles sont la cause de l’assèchement de la nappe phréatique du parc naturel.
Les travailleuses, immigrées, qui soignent ces cultures, les récoltent et les conditionnent sont la plupart du temps en contrats précaires, payées en dessous des tarifs conventionnels, les heures supplémentaires non payées, les passeports confisqués… Les syndicats, bien sûr, sont interdits de séjour.
A côté, en Andalousie, de petits producteurs bio travaillent de façon traditionnelle, commercialisent en circuits courts ou à travers des coopératives.
Au Sud du Maroc, en particulier dans la province de Chtouka Aït Baha, d’importantes exploitations produisent massivement des fruits et légumes bio pour l’exportation sans considération pour les dégâts environnementaux et sans respect du droit du travail : salaires inférieurs au salaire minimum, salariées non déclarées ni inscrites à la caisse de sécurité sociale… Après avoir épuisé les terres et la nappe phréatique du Souss, ces entreprises se reportent, avec les mêmes méthodes, vers la région de Dakhla, au Sahara Occidental (sous domination marocaine en dépit des résolutions de l’Onu).
La GD est arrivée
Après avoir considéré le bio comme une niche (1992, apparition des premiers produits bio chez Carrefour), la grande distribution a fortement développé ce créneau à partir de 2008. Elle a alors décidé d’éliminer ses concurrents (les magasins spécialisés avant tout) ; cela avec un argument déjà utilisé pour le conventionnel, « la défense du pouvoir d’achat des consommateurs » et les prix bas.
Le conditionnement de tomates bio, en Espagne.
Photo Philippe Baqué.
Cela n’empêche pas la GD de réaliser des marges importantes sur les produits bio, d’imposer des prix bas aux fournisseurs, à travers les marques distributeur, et d’oublier de parler du revenu des producteurs (et de leur « pouvoir d’achat »).
Résultat, la GD maîtrise aujourd’hui en France 47 % du chiffre d’affaires du Bio. Ces produits bio sont en bonne partie importés, produits dans des pays où le prix de la terre est peu élevé, la main-d’œuvre peu coûteuse. La GD française les achète à peine plus cher que les produits conventionnels, parfois moins cher, et réalise dessus des marges très importantes.
Retour aux fondamentaux ?
« La Bio entre business et projet de société » rappelle les principes fondateurs de la Bio et retrace le développement de l’agriculture biologique : coopérative Demeter (1932), Association française d’agriculture biologique (1962), Nature & Progrès (1964), Ifoam (fédération internationale, 1972), Fnab (1978).
Puis la reconnaissance officielle de l’agriculture biologique (1980) et le processus jusqu’à la naissance du label européen (2009), plus laxiste que le label français (lequel, désormais, ne peut plus imposer un cahier des charges plus rigoureux que le cahier des charges européen). Un processus de reconnaissance qui aboutit à la « confiscation » de la labellisation par les pouvoirs publics… au profit du lobby agro-industriel et de la grande distribution ? (1)
Le livre ouvre le débat sur les avantages comparatifs du SPG (système participatif de garantie), créé par Nature & Progrès, et de la réglementation européenne. D’un côté une relation de confiance producteurs-consommateurs (qui inclut aussi des contrôles) ; de l’autre, une certification où le certificateur « indépendant » contrôle les entreprises productrices… qui sont ses clients et le font vivre.
Le parcours des « acteurs de la Bio » en France est lui aussi instructif, du mouvement militant aux entreprises dont certaines ont peut-être perdu de vue leurs objectifs d’origine. La plupart se sont mises à travailler avec la grande distribution, comme passage obligé du développement ; certaines en reviennent.
Biocoop, pionnier de la distribution bio, est devenu un réseau de commerçants indépendants (2) où la partie coopérative se limite à la centrale d’achat. S’il conserve une vie démocratique, avec de vrais débats, les consommateurs et les producteurs sont peu impliqués dans les décisions. Et la course au développement commercial a pris le dessus, entraînant des pratiques contestables du point de vue de l’éthique de la bio : importations de contre-saison, produits de la bio industrielle mis en avant (pour leurs prix inférieurs), produits issus d’entreprises sans éthique sociale… Est-ce le résultat d’une perte de contrôle de la base ?
Mais le mouvement social à l’origine des Biocoop dans les années 1980 réapparaît sous diverses formes : groupements d’achat, Amap (la charte des Amap est écrite en 2003 par Alliance Provence, le réseau des Amap de Provence-Alpes-Côte d’Azur), boutiques de producteurs fermiers (dont les Boutiques Paysannes en Languedoc)… Le but de ces nouveaux militants : s’éloigner des pratiques de la GD, mettre l’alimentation au centre du débat politique.
Les auteurs de « La Bio entre business et projet de société » proposent, pour parer aux dérives de la Bio et sortir de ses contradictions, un recentrage sur l’agro-écologie. Cette notion regarde la durabilité des agro-écosystèmes, sur le plan environnemental mais aussi en terme de bien-être des sociétés humaines. Elle donne une part prépondérante aux savoirs paysans, ce qui n’empêche pas leur propre remise en cause.
Elle va donc bien au-delà de la vision limitative que les organismes de recherche (Inra, Cirad) ont souvent de l’agro-écologie : l’ensemble des techniques agronomiques permettant de préserver l’équilibre écologique. Vision qui a donné notamment l’Agriculture Ecologiquement Intensive et l’agriculture à Haute Valeur Environnementale. Des tendances pour détourner l’agriculture biologique ?
L’agriculture paysanne est capable de nourrir la planète sans la détruire, estiment les auteurs, qui parlent aussi de souveraineté alimentaire, de droit à la terre et d’alimentation biologique accessible à tous. Tout un projet de société.
Philippe Cazal (paru dans le Paysan du Midi du 24/08/2012).
.
1) Pour les aspects réglementaires, voir informations et textes de référence sur http://www.agribio-languedoc-roussillon.fr (onglet « réglementation ») et http://www.bio-provence.org
2) Sept magasins Biocoop seulement ont conservé un statut associatif, dont ceux de Limoux (11), Alès et Saint-Hippolyte-du-Fort (30), Carpentras (84), Mane (04) et Eourres (05). Par contre, celui d’Aix-en-Provence a été le premier à passer du statut coopératif à celui de SARL, en 1991.
.
17 M€ pour encourager la Bio, 196 M€ pour les agrocarburants
L’Etat, à partir du Grenelle de l’Environnement, a beaucoup communiqué sur son accompagnement du développement de l’agriculture biologique en France.
Un appui tout relatif : il suffit de comparer les 17 M€ versés en 2011 à travers un crédit d’impôt aux agriculteurs certifiés (la mesure phare du Grenelle) aux 196 M€ d’aides aux agrocarburants pour la même année.
La Bio en contradiction avec ses semences
Les semences utilisées en agriculture biologique doivent être inscrites au Catalogue Officiel des Espèces et Variétés Végétales, géré par le Gnis (Groupement national interprofessionnel des semences). Or, la plupart des semences de ferme, celles qui font la biodiversité (et l’adaptation des semences à la grande variabilité des conditions de sol et de climat), ne sont pas inscrites au catalogue. Il existe, par exemple, plus de 150 000 variétés de riz ; quelques dizaines sont inscrites au catalogue.
Le cahier des charges bio européen considère comme semence biologique une semence qui a été cultivée en bio au moins une génération. La semence bio est donc une semence conventionnelle cultivée un an en bio.
Les semences conventionnelles sont en grande majorité issues de la sélection génétique par hybridation, ce qui est contradictoire avec deux des principes de la Bio : le choix des processus naturels pour la sélection de variétés nouvelles et la recherche de la biodiversité.
La loi du 8/12/2011 durcit les règles d’utilisation des semences de ferme, ce qui fait des semences sélectionnées, inscrites au catalogue, le passage obligé en dehors de la consommation familiale.
Lire aussi « Manger bio« .
La faim, pourquoi ? F. de Ravignan
Publié : 24 mars 2013 Classé dans : Alimentation | Tags: alimentation, faim, ravignan Poster un commentairePlutôt que de vouloir « nourrir le monde », François de Ravignan propose que nous cessions d’empêcher les paysans du Sud de se nourrir eux-mêmes.
« La faim, pourquoi ? » Un défi toujours d’actualité. François de Ravignan. La Découverte & Syros, 2009.
La flambée des prix des denrées alimentaires et les « émeutes de la faim » du printemps 2008 ont fait la Une de l’actualité. Aujourd’hui, la sous-alimentation reste une dure réalité, même si on en parle moins : à ce jour, près d’un milliard d’êtres humains (soit 1 sur 7) souffrent de la faim. Ils habitent majoritairement les pays du « Sud », et en particulier l’Asie et l’Afrique. Et, paradoxalement, ce sont les familles paysannes qui souffrent le plus de la faim.
Pour François de Ravignan, agronome qui a beaucoup travaillé dans et sur ces pays, cette situation est le résultat d’une triple exclusion : exclusion de la terre, exclusion du travail, exclusion du marché.
Il l’explique dans un petit ouvrage (125 pages) paru en 2009 aux Editions La Découverte (réédition actualisée), « La faim, pourquoi ? Un défi toujours d’actualité ».
L’Occident a réussi, par sa « révolution agricole » qui a précédé la révolution industrielle, à acquérir un niveau d’autosuffisance alimentaire (qu’il a d’ailleurs confortée par la colonisation). Les hommes politiques, les firmes de l’agrofourniture, les chercheurs, les responsables agricoles du Nord disent souvent que, pour « nourrir le monde », et donc les pays du Sud, il faut y reproduire les techniques utilisées au Nord.
Pour François de Ravignan, ce modèle n’est pas transposable au Sud. Il ne suffit pas, dit-il, d’augmenter la production pour résoudre le problème de la faim ; et il cite l’exemple de la « Révolution Verte » qui à partir des années 70 a été diffusée notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et dans certains pays d’Afrique : elle exige de gros investissements (semences sélectionnées, engrais, pesticides, irrigation) et, pour cette raison, elle n’a été, le plus souvent, accessible qu’aux paysans les plus fortunés. Les petits paysans, par contre, se sont endettés, sans pouvoir ensuite rembourser leurs emprunts, ruinés notamment par la baisse des prix consécutive à l’augmentation de la production.
Il faut ajouter que cette « révolution verte » a causé de graves dégâts à l’environnement.
La grande majorité des paysans du monde ne sont pas mécanisés : 2 % seulement ont un tracteur. Ils produisent très majoritairement pour l’autoconsommation, sur des superficies souvent trop petites pour nourrir suffisamment leur famille.
Ils n’ont pas les moyens d’acheter semences sélectionnées, engrais, pesticides.
Quant aux OGM (organismes génétiquement modifiés), censés augmenter la productivité, « leur premier effet est de priver les paysans de produire eux-mêmes leurs propres semences », et donc de les endetter.
« Plutôt que la production de masse, la production par les masses »
François de Ravignan, en 2009 devant la Maison Paysanne de Limoux (Aude). Il est décédé en 2011.
Si les agricultures traditionnelles du Sud ne parviennent pas à nourrir leur population, ce n’est pas essentiellement pour des raisons techniques. Les petits paysans du Sud sont souvent découragés de vendre leur production par la concurrence déloyale des denrées alimentaires du Nord : produites grâce aux subventions de la Pac (Politique agricole commune de l’Union européenne) ou de l’Etat américain, et exportées également grâce aux subventions, ces productions du Nord arrivent à bas prix sur les marchés du Sud et amènent les paysans locaux à cesser de produire pour le marché.
Un autre facteur de sous-alimentation au Sud est la production, sur de grandes superficies, par des sociétés multinationales (souvent d’origine française en Afrique), de cultures de rente, de la banane à l’huile de palme en passant par le soja et la canne à sucre. Ces cultures prennent la place des cultures vivrières. Les petits paysans sont souvent chassés de leur terre par ces sociétés, avec la complicité de leurs gouvernants ; les ouvriers agricoles qui travaillent dans ces plantations touchent souvent des salaires de misère ; les productions sont exportées, transformées à l’extérieur, et donc la plus-value et les emplois échappent aux pays du Sud.
Augmenter la production alimentaire, dit François de Ravignan, c’est une chose ; que tous y aient accès est une autre chose. L’amélioration de la situation alimentaire d’ensemble n’est possible que par l’accès du plus grand nombre aux moyens de production : la terre, des prix de vente corrects, l’outillage, les possibilités de transport, la liberté de s’organiser, la faculté de résister à la concurrence de productions étrangères, le crédit.
Sur le plan technique, l’auteur propose de donner la priorité à une meilleure utilisation de l’environnement immédiat, sans dépense monétaire.
Et il cite Gandhi (1916) : « L’important, ce n’est pas une production de masse mais la production par les masses ». Il est plus intéressant, poursuit F. de Ravignan, que des milliers de paysans, avec des moyens simples, doublent ou triplent leurs rendements, plutôt que de les multiplier par cinq ou six sur de grands périmètres où ne travailleront que quelques centaines de salariés (exemple d’un projet de périmètre irrigué au Burkina Faso).
Parmi ces « méthodes simples » : des semis à la bonne date, la fertilisation organique, un désherbage soigneux, l’acquisition commune d’intrants dont le matériel.
Dans sa conclusion, François de Ravignan souligne que les solutions à la faim dans le monde se trouvent aussi « ici » : il ne s’agit pas de savoir « comment nourrir l’humanité » mais « comment ne pas l’empêcher de se nourrir elle-même ». Il s’agit donc de mettre fin au mythe du « Progrès », du « Développement » et aux solutions occidentales de rentabilité maximale de l’économie, de guerre économique.
Il s’agit de fonder une nouvelle économie non pas sur le principe de la concurrence mais sur ceux de la complémentarité et de la solidarité.
Car, pour François de Ravignan, « la faim n’est que le symptôme le plus accusé de notre déshumanisation ».
Mais l’auteur ajoute que ce problème d’exclusion d’une partie de l’humanité n’est pas qu’un problème Nord-Sud. L’exclusion se produit aussi, et de plus en plus, au Nord, vis-à-vis des chômeurs ou encore d’une partie des agriculteurs. Raison de plus d’inventer un nouveau système économique et un nouveau mode de relation entre humains.
Philippe Cazal (paru dans le Paysan du Midi du 12/06/2009).
* * * * *
Une « Association des Amis de François de Ravignan » a été constituée en 2011. Elle a tenu ses 2es Rencontres du 21 au 23 juin 2013 à Camps-sur-l’Agly (Aude). Renseignements : jeanlabourgade@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur François de Ravignan, voir le site de l’association (ci-dessus), le site de La Ligne d’Horizon ou encore lire le n°68 (2013) de la revue Horizons Maghrébins sur « l’Afrique en mouvement ». Il rassemble notamment 12 articles sur « François de Ravignan, une passion pour la terre et ses petits paysans ».
* * * * *
Lire aussi, sur ce blog, « L’alimentation, un bien public, pas une marchandise« .

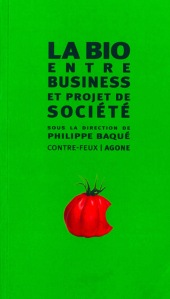




Commentaires récents